
Amarcord, 1973, Fellini
« Je n’aime pas du tout cette époque où il me faut vivre. Je ne sais si j’en aurais préféré une autre parce qu’il est impossible de le savoir. Je sais seulement que je trouve cette époque haïssable et que je la hais. Je ne la juge pas : je la hais. Il m’est pourtant arrivé de penser qu’il existe en cette époque des choses essentielles et précieuses pour moi, auxquelles je ne voudrais renoncer pour rien au monde. Je place parmi ce choses les poèmes de Sandro Penna ; les livres d’Elsa Morante ; les films d’Ingmar Bergman. »
Ecrivaine italienne majeure, ayant centré son œuvre sur la mémoire familiale, les relations humaines, la politique et la vie quotidienne, Natalia Ginzburg (1916-1991 est une âme noble.
Epouse de Leone Ginzburg, militant antifasciste torturé et tué en 1944, mère de l’historien Carlo Ginzburg, l’auteure de Lessico famigliare (Les mots de la tribu, 1963) a écrit des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre, des essais, mais aussi des articles de journaux pour La Stampa et Il Corriere della sera, repris dans un beau recueil publié par Ypsilon Editeur, Vie imaginaire.
Composé de deux parties – des points de vue sur l’art et les artistes ; des réflexions générales témoignant d’un esprit très franc -, Vie imaginaire se déguste, tant l’écrivaine ne cherche pas à se conformer à la doxa du moment – non politiquement correcte, dirait-on aujourd’hui.
Savoir admirer (la poésie de Biagio Marin, l’écriture d’Antonio Delfini et d’Elizabeth Smart, le critique Niccolo Gallo, le film Un dimanche comme les autres, de John Schlesinger, le philosophe Felice Balbo, une nouvelle de Goffredo Parise, Amarcord, de Fellini, La Storia, d’Elsa Morante, Les contes italiens, d’Italo Calvino), c’est aussi savoir exprimer ses déceptions, son désintérêt ou son dégoût (La Grande Bouffe, de Marco Ferreri, Le vice absurde, de David Lajola et Diego Fabbri, un spectacle où son ami Cesare Pavese est offensé, les poèmes Epitaffio, de Giorgio Bassani, apprécié par ailleurs).
Si Moi et Lui, de Moravia, lui semble écrit par et pour son image publique, Natalia Ginzburg n’oublie pas la grandeur du livre Les Indifférents : « Dans le monde qui m’entourait, confie-t-elle, un monde qui me paraissait mort et momifié, il m’a semblé qu’une vie soudaine frémissait. Le monde qui m’entourait était l’Italie du fascisme, le vrai y paraissait toujours voilé et distant, insaisissable comme un fantôme, le retrouver et le toucher semblait une entreprise désespérée. (…) Moravia me semblait être le premier à s’être levé, à avoir bougé et marché dans la direction précise du vrai. »
Il y a la Moravia de la tête, raisonneuse, et le Moravia humble, du cœur, secret – donc limpide, touchant, inspirant.
Les deux articles sur Bergman sont superbes : « Je pense que personne ne sait aussi bien que lui comment les femmes pleurent. Personne ne sait aussi bien que lui comment les femmes se lèvent le matin dans l’angoisse, comment elles se lavent les dents, comment elles marchent pieds nus à travers les pièces, comment elles tombent amoureuses et comment elles accouchent. (…) Personne n’a compris aussi bien que lui comment les gens meurent et comment nous pleurons les morts. »
Natalia Ginzburg possède l’art de portraiturer les personnes qu’elle fréquente : « Hier un ami est venu me voir. Il s’appelle Tonino Guerra [écrivain et scénariste de cinéma]. Il est petit, brun, pâle. Il porte toujours des habits en velours côtelé et des casquettes. Chaque fois que je le vois, j’ai l’impression que ses habits sont imprégnés de brouillard et qu’il sort d’une forêt automnale où il chasse le lièvre. On dirait qu’il a foulé des tapis de feuilles sèches et des berges boueuses et qu’il a des noisettes dans la poche et un lièvre caché sous la veste. »
Rome est l’objet d’un amour ambivalent, admirée pour son passé, ses lieux de secours (les jardins du Quirinal) et son tempérament, mais détestée pour son envahissement par les automobiles.
Le ton se fait parfois caustique, notamment quand il s’agit d’évoquer les femmes, et la condition féminine : « Chez les femmes, la première chose qui vieillit c’est le cou. Un jour, elles se regardent dans le miroir, le cou plein de rides. Elles disent : « Mais comment est-ce arrivé ? » Elles veulent dire « comment se fait-il que ça me soit arrivé à moi ? à moi qui étais jeune par nature et pour toujours ? » Elles avaient l’habitude de se laver le visage au savon. Dans les magazines où l’on parle du soin de la peau, il est écrit qu’il ne faut jamais toucher son visage avec du savon. Elles pensaient cependant que leur visage était une exception, qu’il était réfractaire aux crèmes et fait pour être savonné énergiquement. (…) A quarante ans, elles ont commencé à se demander comment faire pour ne pas devenir cet animal ridicule, antipathique et triste qu’on appelle la femme d’âge mûr. »
A propos de Noël : « Il est vrai que les enfants attendent des jouets pour Noël et paraissent les désirer. Mais l’idée qu’en réalité ils s’en moquent et que comme nous ils perçoivent très vite la misère de l’imagination qui les a fabriqués règne dans notre esprit et y répand pessimisme et perplexité. »
Les réflexions sur les juifs choqueront peut-être, mais elles sont particulièrement fécondes : « Je suis juive et j’ai eu une éducation bourgeoise. Cette éducation bourgeoise m’a instillé quelques idées fausses. D’une manière ou d’une autre, j’ai dû respirer, dans mon enfance, l’idée que les Juifs et les bourgeois avaient des droits et une supériorité sur les autres. (…) A propos des Juifs d’Israël, je crois avoir pensé qu’ils avaient des droits et une supériorité sur les Arabes. A un moment donné, cette idée m’a paru monstrueuse. Je l’ai arrachée et piétinée furieusement. (…) La douleur et le massacre d’innocents que nous avons regardés en face et dont nous avons souffert ne nous donnent aucun droit sur les autres et aucune sorte de supériorité. Ceux qui ont porté sur leurs épaules le poids de la terreur n’ont pas le droit d’opprimer leurs semblables par l’argent ou les armes, tout simplement parce qu’aucune âme qui vive n’a ce droit au monde. (…) Nous n’étions pas du tout préparés à les voir devenir une nation puissante, agressive et vindicative. Nous espérions qu’ils formeraient un petit pays inoffensif, recueilli, que chacun d’eux conserverait sa physionomie gracile, désenchantée, pensive et solitaire. Ce n’était peut-être pas possible. Mais cette transformation fait partie des choses horribles qui se sont produites. Quand quelqu’un parle d’Israël avec admiration, je sens que je suis de l’autre côté. J’ai fini par comprendre, tard sans doute, que les Arabes étaient des paysans et des bergers pauvres. Je sais très peu de choses de moi, mais je suis sûre et certaine que je ne veux pas être du côté de ceux qui utilisent les armes, l’argent et la culture pour opprimer des paysans et des bergers. »
La conclusion de l’article Liberté est admirable : « Chaque mot nous semble aujourd’hui si tremblant et vacillant que nous ne sommes sûrs de rien. Pour chaque bien que nous possédons, nous nous demandons s’il ne s’agit pas d’un vol. Nous ne sommes pas du tout sûrs que nos expressions de liberté ne volent pas quelque chose aux autres. Il serait peut-être juste et nécessaire que chacun pense non pas à sa liberté, mais à celle des autres. Si chacun pensait à celle des autres plutôt qu’à la sienne, si chacun était disposé à protéger celle des autres au lieu de la sienne, nous serions alors plus proches d’une juste répartition de biens, de privilèges et de liberté entre les hommes. »
Avec Natalia Ginzburg et quelques autres, morts ou vivants, refonder une Europe de l’esprit.
N’est-ce pas Carlo Ossola ?
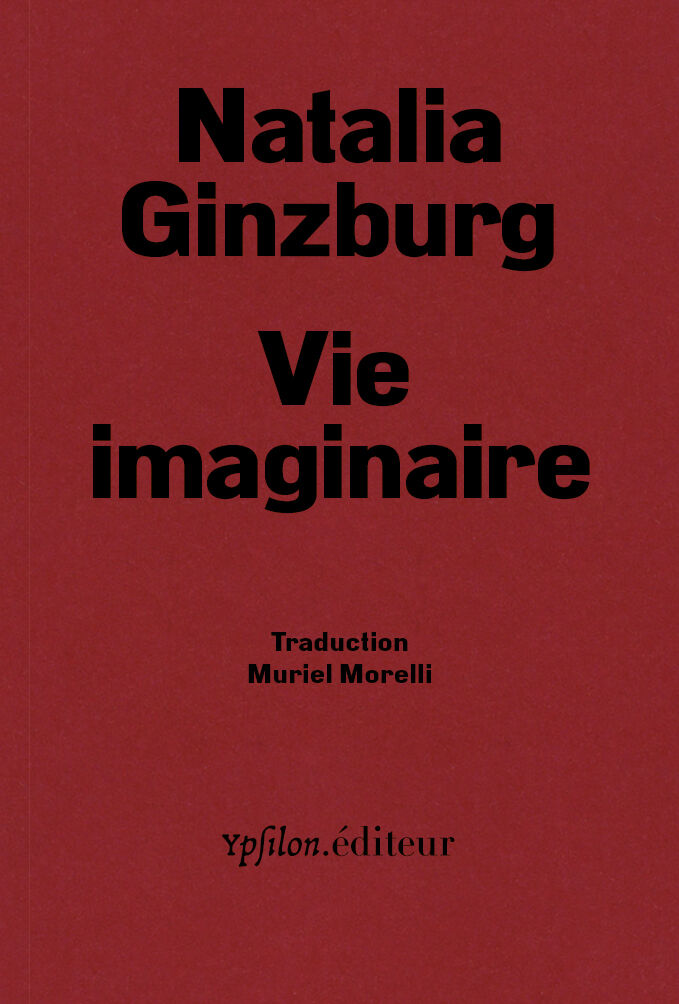
Natalia Ginzburg, Vie imaginaire, traduction Muriel Morelli, mise en page & couverture Pauline Nunez, Ypsilon Editeur, 2025, 264 pages
https://ypsilonediteur.com/auteurs/natalia-ginzburg
