
Chercheur associé à l’université Paris Descartes et à la SFPA (Société Française de Psychologie Analytique), docteur en philosophie, Bruno Traversi, par ailleurs enseignant d’aïkido, explore la structure inconsciente du mouvement à partir des écrits de Plotin, de la correspondance entre le psychologue C.G. Jung et le physicien Wolfgang Pauli, et des pensées du Japonais Morihei Ueshiba.
La publication récente chez L’Harmattan de ses travaux, fruits d’une dizaine d’années d’études inlassables sur le sens même du mouvement, est à considérer comme une véritable chance de comprendre au mieux les liens entre cité idéale et spontanéité autonome, tout en tentant de rétablir un ordre désormais vicié par les logiques d’expropriations permanentes dans lesquelles nous vivons avec un sentiment d’incarcération.
L’originalité de la pensée de Bruno Traversi est totale.
Il convient de l’écouter avec le plus grand soin.

Pouvez-vous pour commencer évoquer en quelques mots l’objet de votre thèse de troisième cycle en philosophie, dont votre livre, Le corps inconscient, Et l’âme du monde selon C. G. Jung et W. Pauli (L’Harmattan, 2016) est issu ?
J’ai fait ma thèse de doctorat en philosophie à l’Université de Paris X de Nanterre sous la direction de Jean-François Balaudé, professeur de philosophie et président de cette même université. L’objet de ma thèse, « La danse comme spontanéité – hypothèse d’une structure inconsciente du mouvement », est de distinguer deux types de spontanéité en comparant plusieurs formes de pratiques corporelles, notamment de danses occidentales et orientales, antiques et contemporaines. Pendant ma thèse, j’ai également eu la chance d’être conseillé par Michel Cazenave, qui a préparé l’édition des Correspondances Jung-Pauli chez Albin Michel, et qui est en France, comme vous le savez, le spécialiste de l’œuvre de Jung et de Pauli.
Vous distinguez deux formes de spontanéité, la spontanéité autonome et la spontanéité hétéronome. Comment les comprenez-vous ?
Mon étude s’articule entièrement à partir de la distinction que je fais d’emblée entre la spontanéité entendue comme réponse réflexe à l’environnement, que je qualifie de « spontanéité hétéronome », et la spontanéité comme acte provenant de soi, indifféremment au milieu ambiant, que je désigne par « spontanéité autonome ». Au fil du livre, je mets au jour la structure de cette spontanéité autonome, en montrant qu’elle s’enracine dans une couche profonde de la psyché, couche que Jung et Pauli qualifient de « collectif », au sens de partagée, et de « psychoïde », c’est-à-dire dépassant la dualité entre physique et psychique. C’est proprement la nature psychoïde de la psyché qui doit résoudre, selon eux, le « problème psychophysique », c’est-à-dire la dualité apparente de la sphère physique et de la sphère psychique. La dualité du physique et du psychique qui caractérise notre niveau de réalité serait donc dépassée par l’existence d’un autre plan plus fondamental.
Votre travail prend acte d’une rupture épistémologique avec la physique classique.
Le « problème psychophysique » qui est au centre des échanges entre le physicien et le psychologue renvoie à la révolution scientifique qui redéfinit complètement le rapport au savoir à cette époque, au cours de la première moitié du XXe siècle. L’avènement de la physique moderne, tout d’abord de la relativité d’Einstein, puis de la mécanique quantique, constitue une rupture avec le modèle de la physique classique qui était au soubassement du paradigme culturel depuis plusieurs siècles. Le développement de la physique classique a reposé, en effet, sur une distinction claire et nette entre la sphère physique et la sphère psychique, césure qui permettait de distinguer le sujet et l’objet, ou encore l’observateur détaché du fait observé. Or, c’est cette distinction que les résultats de la physique quantique remettent profondément en cause. C’est en cela que l’avènement de la quantique constitue une révolution : elle touche au fondement de la science, à ses principes les plus élémentaires.
Le « problème psychophysique » (formulation de Jung-Pauli) tel que vous l’étudiez dans votre livre est-il aussi un « problème » pouvant relever des sciences de l’éducation, c’est-à-dire d’un changement de paradigme quant aux priorités éducatives ?
Puisqu’il y a l’émergence d’un nouveau paradigme, il y a nécessité de repenser l’éducation qui a proprement la charge, à travers son devoir de transmission d’une génération à l’autre, de la continuité et de l’évolution du paradigme culturel – c’est-à-dire de la manière avec laquelle les individus, au quotidien, perçoivent le monde et s’y inscrivent par leurs actes (dans le double rapport au monde intérieur et au monde extérieur, à soi et à autrui). Comme en fait le constat Étienne Klein, en introduction à Conversations avec le sphinx (Albin Michel, 2014) : « La science domine certes mais les idées sociales, politiques et économiques qui prévalent aujourd’hui ont presque toutes été façonnées, consciemment ou non, par une vision du monde fondée sur les résultats d’une science du XIXe siècle. Nous continuons à voir la science un peu comme la voyaient nos grands-parents. » L’on pourrait aisément se méprendre en pensant que les découvertes bouleversantes de la science physique moderne ne concernent que le monde de l’infiniment petit. En réalité, elles signifient que la réalité ne possède pas un seul niveau, mais plusieurs niveaux, chaque niveau étant ce qu’il est en fonction du niveau « précédent » et possédant pourtant ses propres lois et sa cohérence interne. Prenons l’exemple du temps. Si nous le vivons comme étant linéaire et orienté – nous disons qu’il existe une « flèche du temps » possédant une réalité aussi bien psychologique que physique –, cette temporalité n’a plus cours à un niveau plus fondamental de la réalité physique et de la réalité psychologique. Il y aurait donc une forme d’atemporalité primaire et une temporalité fléchée secondaire qui apparaîtrait à partir d’un certain seuil de développement. L’existence de ces deux niveaux nous pose problème en ce que nous n’arrivons pas à saisir leur transition. Mais cette difficulté semble être elle aussi liée au fait que nous réfléchissons encore à partir du modèle de la physique classique qui est gouvernée par le concept de continuité, tandis que la physique quantique l’est, comme on le sait, par celui de discontinuité. Ainsi, la rupture de niveau constituerait l’essence même de leur articulation et donc de leur unité.
Il en est de même pour la causalité et l’acausalité. A mon sens, l’éducation devrait donc prendre en charge ce nouveau paradigme en conduisant, tout d’abord, la jeune génération à « voir » le monde comme étant constitué de différentes strates, ce qui impliquerait de passer de la rationalité à une « transrationalité », autrement dit de passer d’une logique du tiers exclu à une logique du tiers inclus. Si cette vision du monde était donnée dès le plus jeune âge, elle deviendrait naturelle, alors qu’elle exige toujours pour l’adulte un effort de décentrement par rapport à la rationalité du tiers exclu et à la vision d’un monde ne possédant qu’un seul niveau, image du monde qui nous habite depuis l’enfance. Une telle éducation permettrait peut-être alors l’émergence d’un nouvel instinct scientifique et à terme l’émergence de la « nouvelle science » que prophétise, si l’on peut dire, Pauli dans ses écrits. La « nouvelle science » que pressent Pauli réunirait la physique et la psychologie, en intégrant un plan plus fondamental dont la nature est à la fois physique et psychique, ou ni l’un ni l’autre – sorte de nature neutre. L’on voit bien, là aussi, combien l’éducation doit être modifiée pour intégrer cette nouvelle perspective.

En quoi la structure du mandala est-elle révélatrice d’un ordre transcendant ?
Le mandala est un terme que l’on peut qualifier de « transdisciplinaire », il est employé en effet aussi bien en sciences des religions, en science physique, en psychologie des profondeurs, en histoire, et bien entendu en art. Chacun connaît les mandalas de la tradition bouddhiques, mandalas peints, sculptés, dansés ou même érigés en monument, et exprimant l’ordre cosmogonique bouddhique. Jung, de son côté, observe que certaines de ses patientes, dans un état de semi-inconscience, tracent spontanément des figures dont les formes sont typiques de celles du mandala. Il observe que ces dessins ont une fonction apaisante et régulatrice sur le plan psychologique. Ils correspondent, lui semble-t-il, à une refondation intérieure par laquelle l’individu retrouve un certain degré d’unité. Le philologue et historien des religions Charles Kerényi, quant à lui, note que des formes identiques à celles du mandala structurent les rituels de fondation des villes, voire des plans à partir desquels s’érigent et se développent les cités, et cela tout autant dans les cités romaines que dans celles de l’Afrique occidentale par exemple. Il en déduit qu’elles possèdent une valeur politique, c’est-à-dire une valeur quant à l’organisation et la régulation de la vie de la cité. Nous avons donc le mandala comme symbole de l’ordre cosmique chez les bouddhistes, le mandala comme fonction régulatrice et organisatrice du monde intérieur chez Jung, et enfin le mandala comme symbole et structure organisateurs de l’espace collectif chez Kerényi. Comment comprendre la nature opératoire du mandala à travers ces trois niveaux ? C’est la question qui guide mes recherches depuis une dizaine d’années.
Quels ont été vos protocoles de recherches ?
J’ai organisé, à partir de 2006, des ateliers de danse Kagura Mai, forme de danse extatique de type mandala. J’avais déjà observé, depuis plusieurs années, que certaines personnes pouvaient se déplacer en rythme selon une architecture typique du mandala – dans un état de dissociation avec leur milieu et donc sans en avoir conscience. Pour ma thèse, j’ai décidé de réitérer ces états de transe et de laisser le mandala apparaître et se déployer, comme de lui-même, c’est-à-dire en-deçà de la volonté et de la conscience du sujet. Toutefois, à la différence d’avec les situations que j’avais observées jusqu’alors, je décidais d’aménager des situations impliquant simultanément plusieurs individus (de trois à cinq), afin de pouvoir étudier de quelle manière la structure et la dynamique du mandala peuvent avoir une double fonction ordonnatrice et régulatrice, tout à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif. Lors de ces ateliers, mon approche a été phénoménologique : il s’agissait pour moi, après avoir évacué, ou mis entre parenthèses, les croyances et les études concernant le mandala, de décrire les faits à la fois intérieurs (sensations, idéations des sujets impliqués) et les faits extérieurs (ce qui se donne à voir à l’observateur). Je dois dire que la situation s’est révélée bien plus heuristique que je ne l’avais imaginée : je suis allé d’étonnements en étonnements au cours de ces quelques années. Je ne peux vous passer en revue tous ces moments de découvertes, mais disons que l’une des principales a été de constater que le mandala (j’entends par là l’architecture typique des mandalas), au sein de ce collectif, d’une part, apparaissait et se développait d’une manière collective, telle une structure dont chacun contribuait à faire apparaître un aspect, et, d’autre part, permettait à l’ensemble du groupe, du chœur, de s’ordonner spontanément. Cet ordonnancement spontané du collectif se caractérise positivement par sa nature géométrique, et négativement par une disparition des processus d’adaptation, que nous mettons en œuvre ordinairement en face des fluctuations du milieu. J’avais donc sous les yeux la mise en œuvre d’un principe inconscient, se manifestant à travers la motricité des corps en présence, résolvant la dualité entre la spontanéité individuelle et l’ordre collectif – dualité qui est, comme vous le savez, à l’origine de toutes les questions et des difficultés politiques. Ces observations semblent donc témoigner en faveur de l’existence d’un plan transcendant, ou d’un autre niveau de réalité, qui serait principe d’ordre et dont le mandala constituerait le dépliement spatial et temporel, autrement dit le « reflet » pour reprendre le terme de Pauli. Nous retrouvons donc là l’idée de Jung que le mandala représente un « archétype d’ordre ».
En quoi la danse contemporaine, dans sa volonté de retrouver assez souvent une spontanéité originaire, si l‘on songe au Buto ou à la danse Contact Improvisation de Steve Paxton, fait-elle fausse route selon vous ?
Il y a, en effet, dans le Buto comme dans la danse Contact Improvisation de Steve Paxton, la volonté de retrouver une spontanéité originaire, et par là de renouer avec un corps primordial. Par ailleurs, selon leurs zélateurs, la pratique de cette spontanéité doit conduire à un renouvellement de la société. Dans leur histoire, leurs thématiques, leurs formes, ces deux danses sont tout à fait différentes l’une de l’autre. Néanmoins, elles reposent toutes les deux sur une spontanéité de type réflexe ou réactive, que j’ai qualifiée d’« hétéronome ». Pour ces deux pratiques contemporaines, danser de manière spontanée signifie délaisser la raison avec ses cogitations, délaisser la volonté, l’intention même, pour libérer le corps de l’emprise de la volonté moïque, pour le laisser réagir spontanément (naturellement) à son environnement, et retrouver ainsi avec celui-ci – et ce qu’il contient de choses et de personnes – une forme d’unité et de totalité originaires. Cependant, en procédant de cette manière, ces danseurs ne reconnaissent uniquement que la spontanéité « hétéronome », mettant de côté, car ne la soupçonnant pas, la spontanéité « autonome » comme acte provenant de soi indifféremment au milieu. Or, cette forme de spontanéité exige, pour être vécue, non seulement de cesser les cogitations, mais surtout de se détourner des données de la sensibilité pour diriger toute l’attention vers le monde intérieur. Ainsi, la différence essentielle qui existe entre la danse du mandala comme j’ai pu l’observer, d’une part, et la danse du Buto ou la danse Contact-Improvisation d’autre part, est une orientation du « regard », c’est-à-dire de l’attention : alors que les danseurs contemporains sont entièrement tournés vers le monde sensible pour laisser le corps s’inscrire et se fondre parmi les choses et leurs fluctuations incessantes, les danseurs du mandala oublient le monde alentour, leur regard étant entièrement tourné vers l’espace central. Soulignons qu’une telle mise entre parenthèses du monde alentour pour atteindre cet espace central n’est pas chose aisée, elle demande une forme d’ascèse ; tandis que la spontanéité hétéronome relève d’un laisser-aller intégral. Ce double sens de la spontanéité (shizen en japonais), avec les pratiques corporelles qui en découlent, n’est pas nouveau. Il traverse l’histoire du bouddhisme aussi bien que du taoïsme, donnant lieu à des conflits doctrinaux et à des différences de pratiques. Toutefois, d’une manière générale, les doctrines et les pratiques qui considèrent la spontanéité au titre de laisser-aller ont toujours été regardées comme des dévoiements de la doctrine. De ce point de vue, il me semble tout à fait impropre de rapprocher le Buto de l’idée d’unité que recherche le bouddhisme en général.
Ainsi, les danseurs contemporains, lorsqu’ils ne prennent en compte que la spontanéité hétéronome pour retrouver un corps « authentique », qu’ils identifient au « corps animal », me semblent se fourvoyer en ne considérant qu’une partie de l’activité corporelle – cette perspective et cette pratique répondent en réalité tout à fait au paradigme de la science physique classique et particulièrement à la nature et au statut que confère Descartes au corps : il est pour lui telle une machine qui se caractérise par sa capacité à réagir à son environnement de manière automatique. Le corps ne posséderait ainsi qu’une semblance d’autonomie. En réalité, il serait constamment déterminé par le cours des choses, autrement dit constamment hétéronormé. C’est d’ailleurs là le projet explicite de Paxton, de retrouver la nature authentique du corps qui est de s’inscrire parmi le cours des choses selon les lois de la mécanique (rouages du corps) : pesanteur et lois d’action-réaction physique (Paxton évoque volontiers Newton). Le paradigme de la science physique classique commencé avec Kepler s’est peu à peu incarné jusqu’à déterminer complètement nos vécus corporels, en évacuant toutes les expériences liées à la « spontanéité autonome ». Mais il est toujours possible de les retrouver, et je crois que l’apport principal de ma thèse est de renouer avec ces expériences du corps, de mettre à nouveau au jour leurs caractéristiques.
Quelle différence faites-vous entre le sol et le lieu ?
Cette distinction nous place véritablement au cœur du problème de la différence entre spontanéité autonome et spontanéité hétéronome. Vous savez que l’un des projets de la danse contemporaine, et tout particulièrement du Contact-Improvisation, des « Contacteurs » comme ces danseurs se nomment eux-mêmes, est de retrouver les fondements de la communauté, du vivre ensemble, et, partant de là, de refonder la société. Leur ambition est de faire l’expérience d’un collectif qui respecterait la spontanéité corporelle. Selon leur point de vue, il y aurait une forme d’instinct corporel du vivre-ensemble, car sa nature est justement d’interagir avec les autres corps, les êtres et les choses qui l’entourent, capacité naturelle que notre civilisation, fondée essentiellement sur la raison et la domination du corps, aurait perdue, selon eux. C’est un projet quelque peu utopiste, et assez enthousiasmant d’une certaine manière, celle d’une société naturelle qui ne serait plus fondée sur la contrainte du corps mais au contraire sur sa libération, sa spontanéité. A ce titre, toutes les contraintes du corps sont dénoncées, et tout d’abord les contraintes liées aux limitations de l’espace. En effet, ils tiennent ce raisonnement : le corps s’exprime tout d’abord par son déplacement, il a naturellement tendance à traverser l’espace, à parcourir les distances, à se mouvoir dans toutes les directions et vers l’horizon. Aussi, toute limitation de l’espace, tout cloisonnement, constitue une forme d’amputation à cet élan naturel. « Comment le corps contemporain pourrait-il trouver ses libertés ? Et surtout la possibilité d’inaugurer un espace qui lui serait propre ? », s’interroge Laurence Louppe dans Poétique de la danse contemporaine (Contredanse, 2004). L’espace scénique lui apparaît comme contraignant : il « enserre comme dans l’espace d’un tableau, avec ses bords, son centre. », écrit-elle. L’on pense, bien sûr, aux études que Michel Foucault fait de l’organisation de l’espace, du quadrillage des corps comme premier principe d’une mise en ordre de la société par le pouvoir. Il emploie l’expression de « microphysique du pouvoir » pour dire comment le pouvoir s’insinue jusque dans les gestes les plus anodins à travers notamment la discipline scolaire – voir à ce sujet Surveiller et punir. Se trouve dévoilée toute une physique du pouvoir qui est au principe de nos sociétés ordonnées parce que policées. Voilà en quelque sorte ce que la danse contemporaine voudrait dépasser en retrouvant, sous la raison (comme produit de l’éducation), la spontanéité du corps animal. La société qu’elle vise alors est une société « animale », instinctive, qui fonctionne, non pas par une législation imposée et par l’autorité d’un pouvoir central, mais par cet instinct et cette capacité naturels que nous avons d’échanger, de coopérer, inscrits dans notre chair. L’un des modèles évoqués est celui des termites. Cela exige, vous l’aurez compris, de délaisser le lieu – considéré alors comme un aménagement raisonné et imposé de l’espace – pour retrouver le sol, comme espace originel du corps, espace non limité qui lui offre la possibilité de déployer tous les mouvements dont il est capable, et en premier celui de ramper – lui-même considéré comme un mouvement originel. Vous le voyez, de ce point de vue, le sol et le corps animal (mécanique, sensible et réagissant) vont de pair et sont recherchés pour reconstruire une communauté libre.
Mais, il y a dans cette perspective contemporaine, dans ces raisonnements et ces pratiques dansées, un écueil de taille : la spontanéité autonome est complètement évacuée au profit de la spontanéité hétéronome, comme si aucune vitalité, aucune forme ne pouvaient provenir de soi indépendamment du milieu sensible, comme si l’intériorité était tout entière constituée par le dehors. « Il n’y a pas d’intériorité, écrit Véronique Fabbri, […] C’est pourquoi l’intimité se constitue dans le rapport à autrui et ne le précède pas. » Or, lors de la danse Kagura Mai, nous observons une spontanéité autonome qui se déploie suivant des formes géométriques. Autrement dit, la gestuelle spontanée semble suivre, et donc révéler, une structure cachée de l’espace. C’est au sein de cette structure que les corps en mouvements s’ajustent spontanément, sans que ne soient mis en œuvre les processus ordinaires de l’adaptation (basés sur la réaction). Cette architecture cachée se manifeste par l’impression partagée par les sujets impliqués que leurs déplacements sont limités et orientés par des « frontières », des « murs », ou des « couloirs nécessaires », invisibles mais tangibles. Il me semble que cette structure peut être décrite comme le produit d’une extériorisation accompagnant la transe liée à la spontanéité autonome. Comme vous le voyez : « frontières », « murs », « couloirs », nous avons affaire ici à un lieu, c’est-à-dire à un espace orienté commun qui, pourtant, ne relève pas de conventions, d’une construction consciente, raisonnée et volontaire. Il s’agit, il me semble, d’une forme d’instinct – peut-être d’un instinct civilisationnel – inscrit depuis « toujours », aussi bien dans le tréfonds commun de notre esprit, que de notre corps. Vous voyez bien alors en quoi mes recherches sur la spontanéité du corps diffèrent de celles des danseurs contemporains : alors qu’ils considèrent le « lieu » comme un produit de la raison humaine contre la nature, brimant le corps, je le découvre au contraire comme la manifestation et le produit d’une vitalité originelle. Alors que leurs études les conduisent à rejeter le lieu et ainsi le modèle d’une cité structurée par son organisation spatiale, pour rechercher un nouveau type de communauté inspiré du modèle animal, de l’organisation des termites. Je retrouve une structure fondamentale de l’espace du vivre-ensemble qui renvoie au modèle platonicien de l’Ancienne Athènes. Pour répondre à votre question, il me semble donc que les danseurs contemporains expérimentent un corps tronqué de sa part la plus centrale (sa spontanéité autonome) et manquent ainsi l’origine corporelle de nos cités.
Propos recueillis par Fabien Ribery
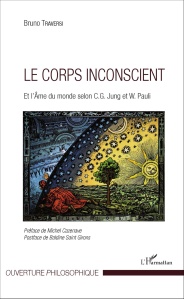
Bruno Traversi, Le corps inconscient, Et l’âme du monde selon C. G. Jung et W. Pauli, préface de Michel Cazenave, postface de Baldine Saint Girons, L’Harmattan, 2016, 260p

Un commentaire Ajoutez le vôtre