
Steffi Graf
« Bien que germaine, l’une de mes cousines est anglaise. Mais ce n’est pas, of course, la seule raison pour laquelle les Britanniques me plaisent depuis longtemps. Ils ont inventé, outre ma cousine, ce qui est déjà considérable, beaucoup de choses indispensables à notre vie quotidienne : la mini-jupe, la pêche de la truite à la mouche artificielle, le tennis, le croquet, les Beatles, les aventures de Sherlock Holmes, des proverbes comme never complain, never explain (ne vous expliquez ni ne vous plaignez jamais), a B.B.C. qui est rarement en grève, lady Dudley chez Balzac, le veau bouilli à la confiture de menthe, et la conduite à gauche le samedi soir. »
Frédéric Berthet n’est pas le plus grand écrivain français du XXème siècle – d’ailleurs, qu’importe ! -, mais c’est un des plus remarquables, auteur d’une poignée de livres fins, drôles, allègres et profonds, Daimler s’en va (1988), Simple journée d’été (1986), Felicidad (1993), Paris-Berry (1993), un volume de correspondances et le merveilleux Journal de Trêve (2006) édité par Philippe Sollers qui l’admirait – sentiment réciproque.
Les éditions La Table Ronde publient aujourd’hui un recueil superbement édité – format vertical, couverture cartonnée orange, édition limitée avec marquage du chiffre sur le dos du livre – de ses articles courts parus dans la presse (Madame Figaro, Le Quotidien de Paris, Le Monde des débats, Le Figaro littéraire).
Dandy, Frédéric Berthet est-il un anarchiste de droite ? Peut-être, et alors ?
L’impassible, c’est la valse des noms qui font mouche – Julien Green, André Malraux, Philip Roth, Franz Kafka, Pierre Drieu La Rochelle, Raymond Carver, Alberto Moravia, Bruno Schulz (liste minimale) – et des propos brillants.
Le papier ivoire est agréable, un peu vintage, c’est parfait.
On vient de garer dans la cour caillouteuse d’une villa de Normandie notre Bentley, on dépose le spencer bleu sur le dos d’un fauteuil en velours bordeaux, on s’installe confortablement dans un fauteuil avec un verre de whisky, portes et fenêtres ouvertes, la lecture peut commencer, reprendre, se réinventer.
On peut converser intérieurement.
Frédéric Berthet fut attaché culturel à l’ambassade de France à New York de 1984 à 1988, il connaît la chanson.
Les titres claquent, intriguent, réjouissent : « Les copains voudront jamais me croire », Le cri du gardon dans Berlin-Ouest », « Madones des sleepings », « Bukowski : sentimental and tonic ».
Eloge de Thomas Bernhard : « A part Céline, je ne vois pas, en France, d’autre comparaison, du point de vue du style, que le Péguy des Cahiers de la Quinzaine. Les phrases s’enroulent en spirales, reviennent, se déplacent et frappent fort à chaque fois. Bernhard tire sur tout ce qui bouge, avec une violence rare, mais dans cette comédie (c’est le sous-titre du roman [Maîtres anciens, 1988]), nulle amertume, beaucoup d’humour. »
Cette dimension d’humour est essentielle pour Berthet – il rêve même d’une Europe de l’humour -, qui déjoue le plombant esprit de sérieux.
Exemple : « Et puis, de toute façon, on le savait bien, mais on n’osait pas le penser : ce n’est pas avec Isabelle Adjani, ou Catherine Deneuve, c’est avec Steffi Graf ou Gabriela Sabatini qu’il faudrait essayer de partir en week-end. »
A propos de Salinger : « Il y a deux choses à dire sur Salinger. La première, c’est qu’on ne devrait même pas adresser la parole aux gens qui n’ont pas lu tous ses livres. Dans les dîners, on refuserait de leur passer le sel. Au restaurant, on les placerait toujours à la table placée à côté des toilettes. Pour eux, les hôtels afficheraient perpétuellement complet. Les chiens des voisins les mordraient. Le soir, chez eux, les plombs sauteraient, et ils se cogneraient dans le noir. D’ailleurs, les gens qui n’ont pas lu Salinger sont à jamais plongés dans l’obscurité. »
Au sujet de Raymond Carver : « L’avantage des Etats-Unis, c’est qu’on peut y devenir un écrivain célèbre en ne publiant que des recueils de nouvelles. Raymond Carver est mort l’an dernier, il n’avait pas cinquante ans. Comme Richard Brautigan, il savait tout de la grande pauvreté et de l’extrême alcoolisme. Il savait surtout, un peu à la façon d’Hemingway, comment raconter une histoire de biais. »
Du premier livre d’Emmanuel Moses, Un homme est parti (Gallimard, 1989) : « Sauf exception, hélas pas toujours justifiée, un premier est, de fait, destiné à une élite. Outre la famille, les amis et les ennemis de l’auteur, quelques centaines d’élus seulement trouveront à se frayer un chemin à travers les librairies. S’il s’agit en plus, en France, d’un recueil de nouvelles, le nombre des lecteurs devient presque aristocratique. L’auteur recevra pourtant quelques lettres, qu’il conservera avec émotion : elles seront signées d’une bergère dans les Alpes, ou d’un détenu de la Santé. Désormais, se dira l’auteur, l’œil embué et le menton volontaire, quoique mal rasé, j’écrirai pour eux. »
Art de la pointe.
Vivacité.
« Moi, ce que je pense, c’est que rien n’a été dit. Ou qu’il faut le redire. C’est ça, c’est qu’il faut sans arrêt le redire. »
Ironie.
Lucidité.
Mais, au fait, la « splendeur de l’indirect » (Henry James), ne serait-elle pas la définition de l’art d’écrire de Frédéric Berthet ?
De son ami Patrick Besson : « Le seul défaut de Patrick Besson, c’est d’écrire dans L’Humanité. Comme quoi, jusqu’où, pour ces êtres rieurs, inquiets et intenables que sont les écrivains, jusqu’où va se nicher leur désir de moralité ? Mais, comme disait Joubert, charmant moraliste du siècle dernier, quand nos amis sont borgnes, regardons-les de profil. »
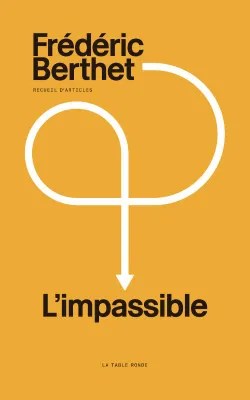
Frédéric Berthet, L’impassible, avant-propos de Robert Cassegrain, La Table Ronde, 2025, 112 pages – 2500 exemplaires numérotés
https://www.editionslatableronde.fr/Auteurs/berthet-frederic
