
Scène côtière vers 1892, Théo Van Rysselberghe
On peut, comme Philippe Sollers, préférer Paul Claudel à André Gide, mais l’on peut aussi ne pas choisir, et lire chacun dans le feu qui le féconde, car enfin – parmi tant de titres – Paludes (1895), Les Nourritures terrestres (1897), L’Immoraliste (1902), Les Caves du Vatican (1914), Les Faux-Monnayeurs (1925), Voyage au Congo (1927), Retour de l’U.R.S.S. (1933), ce n’est pas rien.
La lecture de la correspondance avec le peintre belge installé à Paris Théo Van Rysselberghe n’est pas sans intérêt pour comprendre, au fond, d’où nous venons quand nous appartenons ou croyons appartenir quelque peu à la petite gent littéraire française.
André Gide, souvent qualifié de classique, est le symbole de la qualité française, comme on l’a dit plus tard pour le cinéma.
Georges Perros, pourtant si indépendant, était fier de montrer quelquefois, à Douarnenez où il résidait, la lettre qu’il avait reçue du prix Nobel de littérature 1947 – en ces parages séjourne désormais souvent, outre la famille Gallimard, J.M.G. Le Clézio.
André Gide, c’est un certain esprit du protestantisme français, une rigueur, la préservation des intérêts de la bourgeoisie riche et cultivée, mais aussi le dynamitage par la lettre et l’esprit du carcan des conventions.
Familles, je vous hais, n’est-ce pas ?
Un mariage de façade avec Madeleine, l’amour pour Marc Allégret et les jeunes garçons, un enfant, Catherine, conçu avec la fille, Elisabeth, du couple Maria et Théo Van Rysselberghe.
Un imbroglio, des malentendus, un tissage serré de réseaux d’amitié, l’empire peu à peu bâti de la NRF avec l’aide de Jean Schlumberger.
Il n’est pas déplaisant de voyager avec les amis en Allemagne, à Cuverville, à Ambleteuse, en Italie, en Angleterre, de voir écrits les noms d’Emile Verhaeren – on l’enseignait encore quand j’étais enfant dans les écoles calaisiennes -, des poètes Francis Vielé-Griffin et Henri Ghéon, des peintres Maurice Denis, Odilon Redon, du critique Félix Fénéon, des écrivains Maurice Maeterlinck, Henri de Régnier, Hugo von Hofmannsthal, Francis Jammes, Pierre Louÿs, de l’homme de théâtre Jacques Copeau – une thèse à écrire pour chaque nom en relation avec le grantécrivain (Dominique Noguez) français.
On fait groupe, on marche ensemble, on se désunit, on se recompose.
On tombe malade, on prend des nouvelles de la santé de l’autre.
Neurasthénie, fatigue psychique.
Gide écrit en mai 1900 : « Vos calames sont délicieux. »
En janvier 1904 : « J’apprends que [le peintre Armand] Seguin est mort il y a huit jours. Elle va bien, l’école de Pont-Aven ! »
Maria à Gide en 1905 : « Voulez-vous, cher, vous charger de nous acheter un « tennis » (…) – un jeu complet : piquets, filet, douze ou dix-huit balles, quatre raquettes (deux lourdes, deux plus légères). Je crois que c’est là tout ? Qu’est-ce que cela peut coûter ? 150 F[rancs] ? Un peu plus ? Un peu moins ? Naturellement ne rien donner au luxe […] mais prendre ce qu’il y a de mieux comme qualité, si bien entendu les prix restent à peu près dans mes prévisions. » (l’écrivain répondra le plus aimablement du monde)
Gide à ses amis, en mai 1905, devant une toile de Manet : « Ça, c’est le portrait d’une femme du monde. Remarquez-vous la main canaille ? Et savez-vous pourquoi ?? C’est parce qu’elle vient en avant. Regardez sur une photographie. Moi, j’ai remarqué ça : quand une femme du monde met sa main devant elle, la main paraît trop grosse, tout de suite. Manet a compris ça, tout de suite, lui. Vous remarquerez que c’est encore exagéré par le gant ; vous voyez, le gant noir. Ça grossit les masses. Non, voyez-vous, Manet, ça n’est pas devant la nature qu’il se met, c’est dans la nature – Manet, c’est La Nature. »
26 mai 1906 : « Ibsen a écrit Hedda Gabler à 63 ans ! Je vais un peu mieux depuis que j’ai découvert ça. »
6 janvier 1909 : « Qu’aurais-je d’autre à vous dire ? – On grelotte ; je sors le moins possible ; aspire au travail ; depuis douze jours ai de nouveau un piano ; m’y suis remis avec plus d’amour et de joie que jamais et commence enfin à maîtriser les Ballades [de Chopin]. – Rien de plus beau. »
27 octobre 1912 : « J’arrête ma lettre qui tourne au concierge… »
17 septembre 1914, ce télégramme envoyé par Théo : « Charles Péguy mort devant l’ennemi / Argonne »
Placé au centre de son grand tableau manifeste de 1903 Une lecture, André Gide incarne pour Théo Van Rysselberghe une figure tutélaire du monde des lettres, quand le peintre est pour l’auteur de Si le grain ne meurt (1924) un passeur privilégié vers le monde de l’art.
Programme pour les mois à venir : lire/relire Traité du Narcisse (1891), La porte étroite (1909), Isabelle (1911), La Symphonie pastorale (1919), Corydon (1920), et l’ensemble de son Journal (1889-1949) – sans oublier celui de Paul Claudel.
Et Paul Verlaine, Valéry Larbaud, Stéphane Mallarmé (il assiste à ses fameux mardis), José Maria de Heredia (reçoit les samedis), Paul Valéry, Roger Martin du Gard, Paul Fort, écrivains que fréquenta l’éminence de la rue Vanneau.
Gide était adulé telle une star – de son propre aveu dans des entretiens radiophoniques passionnants avec Jean Amrouche tenus en 1949 – dès qu’il se déplaçait.
La littérature française est géniale.
On lit ceci dans Paludes :
« Que faites-vous vendredi prochain ?
– Être heureux. »
Gide joue du piano, la musique le ravit, sa phrase est reconnaissable entre toutes – lire, pourquoi pas, pour approfondir tout cela, le premier numéro de la revue Année Zéro (Yann Moix), publié en 2022, consacré à l’œuvre gidienne.
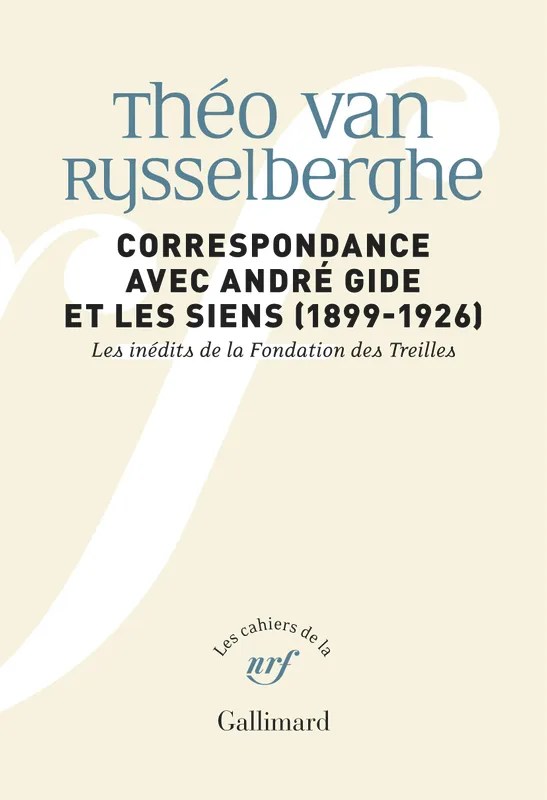
Théo van Rysselberghe, Correspondance avec André Gide et les siens (1899-1926), édition établie, présentée et annotée par Pierre Masson et Peter Schnyder, Les inédits de la Fondation des Treilles, volume 3, Gallimard, 2025, 466 pages
