
L’heureux géomètre, circa 1610 Jusepe de Ribera
« Chez Ribera, peu de chair, beaucoup de sang, le corps avide, sec, sans graisse, vient en avant. La main, puissante comme l’écorce d’un chêne, présente quelques saletés sous les ongles. » (Jean-Paul Marcheschi)
Je n’ai pas vu encore l’exposition Jusepe de Ribera ayant lieu actuellement au Petit Palais (Paris), mais j’ai lu à son propos le texte du peintre et essayiste Jean-Paul Marcheschi, Un petit dépôt de saleté sous les ongles, auteur dont les réflexions sur l’art sont passionnantes – livres sur Piero della Francesca, Goya, Le Greco (liste non exhaustive) publiés à Nantes aux éditions Art 3 – Plessis.
J’ai vu bien entendu çà et là quelques œuvres du peintre espagnol, notamment, à Séville, le tableau représentant une femme à barbe (La Mujer Barbuda), dont on connaît plus souvent la version conservée à Tolède.
Mais que dit l’ami bastiais de Pascal Quignard quand il pense, rêve, contemple Ribera, en rassemblant des notes prises pendant plus de trente ans ?
Vous l’avez compris, je prépare ma visite.
« Je vois des vieillards pouilleux, joyeux, édentés. Des solitaires, des saints, des apôtres en guenilles, des errants, l’œil vif et clair. (…) Le soufre et la lave parcourent secrètement l’art de l’Espagnolet. »
Ribera est volcan, feu, diamant noir.
Les traits de Jean-Paul Marcheschi sont indéniablement ceux d’un peintre : « Le nombre de savoirs engagés dans l’œuvre de Ribera dépasse largement celui déployé dans la stylistique baroque, ils s’expriment souvent dans les détails. Et là, Ribera enrichit considérablement le ténébrisme caravagesque et par bien des côtés, il s’en échappe. chez Ribera, les pigments colorés semblent conserver l’éclat minéral premier : toute la palette des jaunes resplendit séparément, ou bien ensemble, dans les fonds ombreux de son art. Tout à la fois, ou successivement, la main offre des corps tantôt lisses, notamment pour les nymphes, tantôt plus rugueux et comme sculptés pour les personnages masculins – à la « rude bosse », comme l’exprimer Théophile Gautier dans le poème Ribera résumant admirablement son œuvre. »
Que lit-on donc dans le recueil Espana (1845) ?
Prenons le temps :
« Il est des cœurs épris du triste amour du laid.
Tu fus un de ceux-là, peintre à la rude brosse
Que Naples a salué du nom d’Espagnolet.
Rien ne put amollir ton âpreté féroce,
Et le splendide azur du ciel italien
N’a laissé nul reflet dans ta peinture atroce.
Chez toi, l’on voit toujours le noir Valencien,
Paysan hasardeux, mendiant équivoque,
More que le baptême à peine a fait chrétien.
Comme un autre le beau, tu cherches ce qui choque :
Les martyrs, les bourreaux, les gitanos, les gueux
Étalant un ulcère à côté d’une loque ;
Les vieux au chef branlant, au cuir jaune et rugueux,
Versant sur quelque Bible un flot de barbe grise,
Voilà ce qui convient à ton pinceau fougueux.
Tu ne dédaignes rien de ce que l’on méprise ;
Nul haillon, Ribeira, par toi n’est rebuté :
Le vrai, toujours le vrai, c’est ta seule devise !
Et tu sais revêtir d’une étrange beauté
Ces trois monstres abjects, effroi de l’art antique,
La Douleur, la Misère et la Caducité.
Pour toi, pas d’Apollon, pas de Vénus pudique ;
Tu n’admets pas un seul de ces beaux rêves blancs
Taillés dans le paros ou dans le pentélique.
Il te faut des sujets sombres et violents
Où l’ange des douleurs vide ses noirs calices,
Où la hache s’émousse aux billots ruisselants.
Tu sembles enivré par le vin des supplices,
Comme un César romain dans sa pourpre insulté,
Ou comme un victimaire après vingt sacrifices.
Avec quelle furie et quelle volupté
Tu retournes la peau du martyr qu’on écorche,
Pour nous en faire voir l’envers ensanglanté !
Aux pieds des patients comme tu mets la torche !
Dans le flanc de Caton comme tu fais crier
La plaie, affreuse bouche ouverte comme un porche !
D’où te vient, Ribeira, cet instinct meurtrier ?
Quelle dent t’a mordu, qui te donne la rage,
Pour tordre ainsi l’espèce humaine et la broyer ?
Que t’a donc fait le monde, et, dans tout ce carnage,
Quel ennemi secret de tes coups poursuis-tu ?
Pour tant de sang versé quel était donc l’outrage ?
Ce martyr, c’est le corps d’un rival abattu ;
Et ce n’est pas toujours au cœur de Prométhée
Que fouille l’aigle fauve avec son bec pointu.
De quelle ambition du ciel précipitée,
De quel espoir traîné par des coursiers sans frein,
Ton âme de démon était-elle agitée ?
Qu’avais-tu donc perdu pour être si chagrin ?
De quels amours tournés se composaient tes haines,
Et qui jalousais-tu, toi, peintre souverain ?
Les plus grands cœurs, hélas ! ont les plus grandes peines ;
Dans la coupe profonde il tient plus de douleurs ;
Le ciel se venge ainsi sur les gloires humaines.
Un jour, las de l’horrible et des noires couleurs,
Tu voulus peindre aussi des corps blancs comme neige,
Des anges souriants, des oiseaux et des fleurs,
Des nymphes dans les bois que le satyre assiège,
Des amours endormis sur un sein frémissant,
Et tous ces frais motifs chers au moelleux Corrège ;
Mais tu ne sus trouver que du rouge de sang,
Et quand du haut des cieux apportant l’auréole,
Sur le front de tes saints l’ange de Dieu descend,
En détournant les yeux, il la pose et s’envole ! »
Tout ne semble-t-il pas dit du peintre mort à Naples en 1652 ?
« Ribera, complète son admirateur, jette un regard profondément bienveillant sur le monde. Aucune ironie, passion des médiocres et des méchants. Sa délicatesse s’exprime partout. Un certain humour point quelquefois, comme en témoigne le Silène ivre. La gravité des visages n’empêche pas le rire.(…) En sa peinture, tout est pensée, la peinture elle-même est philosophique. »
Identifiant la peinture – faite ou/et regardée – à l’expérience de la joie, l’auteur de L’Alphabet des Astres apprécie chez Ribera sa façon de représenter la vieillesse avec tranquillité.
« Peu d’œuvres comme celle de Ribera s’aventurent dans ces parages où tous les sens sont continûment convoqués. La représentation du corps, de la main où les rides creusent la chair près de l’os, du sang qui coule, c’est la perception d’un corps qui se défait. Et c’est dans l’écorchement de Marsyas que s’ouvrent à nouveau les Sources rouges, sauvages, de la peinture. »
Portrait de Ribera en anatomiste (les riches inventions de la matière), en observateur des diversités humaines, en maître de la peinture à l’huile, des pigments (éclatants) et des drapés, en ami véritable (secours intime).
En moraliste du XVIIe siècle, rigoureux, presque austère, sans emphase.
Aveu : « Quatre livres sont mes guides pour la rédaction de cet ouvrage : Lettres à son frère Théo, de Van Gogh, Oviri ; écrits d’un sauvage, de Gauguin, Jeu et théorie du Duende, de Lorca, et enfin, la vertigineuse Histoire de l’art moderne d’Elie Faure. »
Plus loin : « Une nuit, en rêve, je croise un miroir. Que vois-je ? Un homme à barbe blanche, cheveux hirsutes, visage pâle, émacié – c’est moi. Je reconnais immédiatement le Saint Paul ermite du Louvre. Je suis devenu un Ribera. »
Livre composé de fragments épars issus des journaux de l’auteur, Un petit dépôt de saleté sous les ongles, rappelant la proximité de Manet et de Ribera, inscrit évidemment le peintre dans l’histoire de l’art, tout en lui reconnaissant une pleine singularité : une ivresse spéciale, une jubilation rare, une exigence, qui sont celles de l’art à son sommet.
Je recopie ceci pour Roland Sénéca, estropié des bords de mer, aquarellant les grands mystères, et ami : « Ribera n’a cessé de dessiner jusqu’à la mort, le dessin est son laboratoire. Là aussi, il se révèle novateur. Dans l’immense production de dessins à l’encre, à la pierre noire, à la sanguine, il ne cesse d’expérimenter. Dans cette œuvre graphique, ce ne sont qu’audaces et inventions : impossible de mettre une date sur chacune de ces manières – en cela, il sort de l’histoire et se « désappartient ». »
N’est-ce pas la formule de la liberté ?
Se désappartenir.
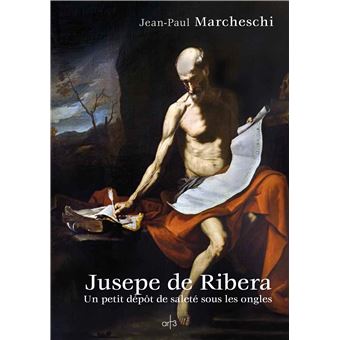
Jean-Paul Marcheschi, Jusepe de Ribera, Un petit dépôt de saleté sous les ongles, Art 3- Editions Plessis (Nantes), 2024, 60 pages
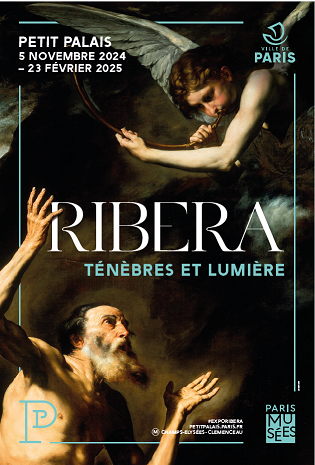
Exposition Ribera, Ténèbres et lumière, Petit Palais (Paris), du 5 novembre au 23 février 2025 – commissariat Annick Lemoine et Maïté Metz