
Pour Gérard Berréby, recherchant la métaphore qui synthétisera une situation, happant çà et là des bribes de phrases, dans une conversation entendue, dans un livre, la poésie n’est pas une activité secondaire de son métier d’éditeur – il est le patron des éditions Allia -, mais la façon la plus juste d’être au monde, .
Né en Tunisie, Gérard Berréby comprend d’instinct ce qui signifie le statut de paria, et la difficulté de se réinventer loin de sa terre natale. Ses poèmes témoignent de la férocité biopolitique actuelle concernant des étrangers considérés souvent comme indésirables.
Mais sa poésie n’est pas avant tout d’ordre sociologique, s’écrivant de l’intérieur de la langue, dans un brassage de mots et de références à la fois savant et sauvage, répondant à la logique du détournement et du cut-up.
Pour s’arracher des usages mortifères de la langue, Gérard Berréby offre à ses lecteurs des armes en poésie.
Aux lecteurs inconnus, aux frères de la nuit, aux insurgés créant des contre-monde invisibles à la plupart, aux femmes désirées, aux floués, aux délaissés, aux grands fous, aux grands sages, à Lautréamont et à Guy Debord, aux enfants.
Il y a une énergie paradoxale dans ces poèmes au ton volontiers apocalyptique.
Vous avez publié trois recueils de poésie en huit ans aux éditions Allia, que vous dirigez, Station des profondeurs (2010), Joker & Mat (2016), La Banlieue du monde (2018) et Comme une Neptune à Lausanne chez Art & Fiction. De quoi procède chez vous la nécessité poétique ? Dans quelles circonstances écrivez-vous ?
J’écris n’importe où, tant chez moi, dans mon environnement quotidien que lorsque je m’éloigne de ma base habituelle. Le besoin d’écrire relève de ce qui se cristallise en moi et reste après avoir été observé, ressenti. La poésie survient quand la réflexion et l’analyse sont dominées par une sensation supérieure qui, à travers une métaphore par exemple, résume tout. Je me joue des mots attrapés au vol, repris d’une conversation écoutée, d’un bout de phrase dans un livre. Bref de tout ce qui constitue mon espace naturel de respiration.
Reprenez-vous vos poèmes, les retravaillez-vous beaucoup une fois écrits ?
Oui et non. Certaines fois, le premier jet est définitif. D’autres fois, le poème traîne pendant des jours, voire des semaines parce que je ne trouve pas son aboutissement.
Qui est Marisa Cornejo avec qui vous avez publié Comme une Neptune ? Pourquoi ce féminin ?
Marisa est une artiste chilienne installée en Suisse. Je ne la connaissais pas avant ce projet. Lors d’une rencontre à Genève, Stéphane Fretz de Art & Fiction m’a remis quelques livres publiés par sa maison d’édition, dont celui de Marisa Cornejo, I am, inventaire de rêves, paru en 2013. Les feuilletant dans le train, j’ai découvert les dessins colorés de Marisa accompagnés chacun d’une légende, et machinalement j’ai commencé à noter les titres puis à les inverser, à les mélanger pour finir par construire ce qui est devenu Comme une Neptune. Chaque dessin comportait un titre en espagnol ou en anglais, traduit en français, et accompagné d’un petit texte. À partir de de la totalité des titres ou presque, j’ai bâti quelque chose de nouveau. J’ai connu Marisa bien plus tard, lorsqu’elle est venue à Paris avec sa famille et m’a rendu visite dans mon atelier. Quand Art & fiction a décidé de publier Comme une Neptune, la maison lui a demandé de l’illustrer. Quant au féminin, il a émergé spontanément, les dessins m’ont attiré et j’ai laissé libre cours à la dérive de mon esprit.
On peut y lire : « Le temps passe longtemps / Quand on ne se sent pas libre / Tout ce temps passé à ne pas le faire / Te souviens-tu comment nous ne l’avons pas fait ? » : la liberté puise-t-elle sa force dans un lien érotique au monde, à l’autre ?
Forcément. La liberté puise sa force dans le lien à l’autre et au monde sous toutes ses facettes. Et donc érotique aussi, érotique forcément.
« Des exilés faisant la queue / Courage pour enjamber / la barrière / Un bateau qui s’éloigne / Des montagnes effrayantes » : en tant qu’exilé tunisien, vous qui venez de publier la réflexion magistrale de la philosophe Hannah Arendt, Nous autres réfugiés sur le statut ambigu de l’émigré, votre poème ne peut-il être que blessé par le sort impitoyable fait aujourd’hui à ceux qui sont contraints de quitter leur pays ?
Blessé certes, mais combatif. Le texte de Hannah Arendt est criant de vérité. En le lisant, j’y ai retrouvé de nombreuses choses subies et ressenties. Il est certain que quand on est contraint d’émigrer, on est rarement le bienvenu là où l’on va, et on se forme sur ce rejet, sa solitude, et ce besoin irrépressible de respirer, de s’exprimer, de s’affirmer, fût-ce au prix d’une grande violence.
J’ai vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de cinq ans, alors que le pays était encore sous protectorat français. J’ai émigré en France à l’âge de quinze ans sans espoir ni désir de retour. Je maîtrisais déjà la langue française usuelle. Bien qu’ayant vécu une autre expérience, j’assume le statut de “paria” évoqué par Hannah Arendt, facette de l’émigré que je suis et dont certains poèmes du recueil donnent à lire la dualité. À moins d’être dans le déni, comment ne pas se reconnaître quand Hannah Arendt écrit : « Nous avons perdu notre langue, c’est-à-dire le naturel de nos réactions, la simplicité de nos gestes, l’expression spontanée de nos sentiments ».
Toutes les expériences humiliantes qui nous sont imposées et auxquelles on ne peut échapper se révèlent constructives. Il faut tirer parti de l’histoire mais aussi de son propre parcours : rien n’est jamais acquis. Au fond de soi, l’on reste toujours un exilé.
Votre technique poétique s’apparente à du cut-up. Ce terme vous convient-il ?
Je voue une passion au détournement, le cut-up, les choses extraites de leur contexte auxquelles j’aime à donner une signification nouvelle… En résumé cela donne :
réutilisation de matériaux/déplacement de mots/mise en relation des mots différents/pas de hasard ni de pirouettes/mix & remix/page et repage/déchets d’œuvres/les mots des autres/expropriation/ appropriation/changer de point de vue/d’angle d’attaque/Schwitters/ Hausmann/Gysin/Burroughs/Bryen/Wolman/Isou/Debord/Nougé/cut-up/cutter colle/Tzara/The Naked Lunch/permutation/réarrangement/Cage Dufrêne/Chopin/musée à vendre/j’écris propre/recomposition/à l’infini
Par quels poètes votre utilisation du vers libre est-elle informée ? Vous êtes notamment très sensible à la liberté poétique venue de Belgique.
Rétif naturellement à toute autorité, école, institution, je me nourris principalement chez les non encartés, les rebelles, les indépendants, les frondeurs. Je suis bien entendu sensible à ce qui s’est exprimé dans la poésie surréaliste belge mais aussi tout autant à Mandelstam qu’à Lautréamont. Pour le reste, je ne suis pas à même d’établir personnellement une quelconque filiation. Disons que mon arbre généalogique demeurera intérieur/intime.
Pourquoi si peu de verbes conjugués la plupart du temps ?
Bien des fois l’expression se contracte, s’épure et tourne à l’instruction, un peu comme pour une prise d’armes.
Vous écrivez dans le poème introductif de La Banlieue du monde : « le faux dans la vraie vie / quand la voie droite était perdue » Qu’est-ce que la vraie vie ? N’inversez-vous pas ici la proposition debordienne concernant le monde spectaculaire : « Le vrai est un moment du faux. » ?
Tout d’abord “la voie droite était perdue” est tiré de L’Enfer de Dante. Je crois simplement prolonger la proposition de la Société du spectacle et s’il s’avère que ce lien opère avec Dante, ce n’est pas pour me déplaire.
« anxiétés communes / dans le brouillard / de la guerre qui vient » : de quelle guerre s’agit-il ?
De la guerre de tous contre tous que nous subissons ici et maintenant, même si beaucoup ne veulent pas le voir.
Le mot « histoire » revient à plusieurs reprises dans votre recueil. Ce mot ne peut-il plus être lié qu’à la dévastation en cours, trouée par des épiphanies érotiques ?
La dévastation omniprésente s’inscrit forcément dans un mouvement de l’histoire. L’observer, la ressentir et l’exprimer m’entraîne forcément dans le cours de ce mouvement. Et puis comment ne pas se penser sujet historique à partir du moment où l’on tente de comprendre, d’agir et de le dire. Il convient de ne pas se laisser dominer par cette noirceur et de trouver le moyen de lui damer le pion. Cette manière d’intégrer l’épiphanie érotique comme vous le dites, est à mes yeux un moyen privilégié.
« moi Zainal Abidu / condamné à mort et exécuté / pour présumé trafic de drogue / j’ai prévenu mes juges / et mes bourreaux / que mon âme errante / les poursuivrait après ma mort » : qui est cet homme ?
Je n’en sais rien de plus que ce que j’en ai écrit dans ce poème. J’ai lu quelques lignes à son sujet dans un journal et le ton quasi biblique de ce Zainal Abidu est resté gravé en moi. J’ai aimé cet inconnu, frère parmi les frères.
Comment envisager aujourd’hui quelque chose de l’ordre de la possibilité d’un sacré ou d’une noblesse d’esprit ?
Il y a en chaque homme quelque chose de sacré, notait Simone Weil. Une grande part de notre environnement participe à l’effacement de ce sentiment. Il s’agit presque d’une discipline quotidienne pour ne pas se laisser submerger et donner un peu plus vie à cette part sacrée située en chacun de nous. Quant à la noblesse d’esprit qui l’accompagne, elle est comparable à un entraînement physique. Il faut apprendre à voir la laideur qui nous entoure et s’impose un peu plus chaque jour, sans se laisser contaminer, et essayer de se rapprocher de ce que beaucoup ont perdu : le regard de l’enfance, spontané et ingénu, loin de l’utile, afin de mieux révéler ce que nous avons enfoui en nous, la meilleure part sans doute.
Votre titre est La Banlieue du monde. Mais celui-ci ne serait-il plus, au fond, qu’une vaste banlieue remplie de mutants, de désespérés et d’objets pollués ?
C’est ce que je vois, je vis et que je suis obligé de partager. Ce qui ne peut s’ignorer. Je pense à ce que disait Hobbes : « Par conséquent, tout ce qui résulte d’un temps de guerre, où tout homme est l’ennemi de tout homme, résulte aussi d’un temps où les hommes vivent sans autre sécurité que celle que leur propre force et leur propre capacité d’invention leur donneront. Dans un tel état, il n’y a aucune place pour une activité laborieuse, parce que son fruit est incertain ; et par conséquent aucune culture de la terre, aucune navigation, aucun usage de marchandises importées par mer, aucune construction convenable, aucun engin pour déplacer ou soulever des choses telles qu’elles requièrent beaucoup de force ; aucune connaissance de la surface de la terre, aucune mesure du temps ; pas d’arts, pas de lettres, pas de société, et, ce qui est le pire de tout, la crainte permanente, et le danger de mort violente ; et la vie de l’homme est solitaire, indigente, dégoûtante, animale et brève. » C’est le monde tel qu’il va ici et maintenant.
Le ton apocalyptique de vos poèmes ne s’est-il pas approfondi depuis le recueil Stations des profondeurs ? Le « je » ne s’est-il pas quelque peu estompé devant la description d’un monde à l’agonie ?
Je place le “je” au centre de tout, comme point de départ. Mais l’envahissement de la laideur et de l’ignorance est tel qu’il a tendance à s’estomper pour mieux revenir en sauveur. On ne choisit pas un ton. Il est affaire de circonstances. On n’écrit pas de la même façon selon les époques et les lecteurs produits par cette époque. Si vous relevez à juste titre un ton apocalyptique accentué, c’est qu’il m’a semblé nécessaire de l’utiliser tant la rage contenue en avait besoin pour s’extirper.
Vos trois recueils forment-ils un même thrène continué ?
Certainement. Un chant du cygne peut-être. Un chant funèbre probablement. Une piste de décollage aussi.
Envisagez-vous votre activité poétique comme votre activité de plasticien comme une réponse à votre travail inlassable d’éditeur, une respiration, une réappropriation de l’intime ?
Encore une fois rien ne peut se faire de bon s’il ne part de l’intime, de soi pour mieux irriguer. Quant à trouver une respiration entre mes différentes activités, c’est certain. Mais au fond de moi il n’y a pas de séparation. C’est un tout. Une chose nourrit l’autre, l’enrichit, la développe. Ensuite c’est selon, j’utilise un moyen d’expression ou un autre.
Propos recueillis par Fabien Ribery
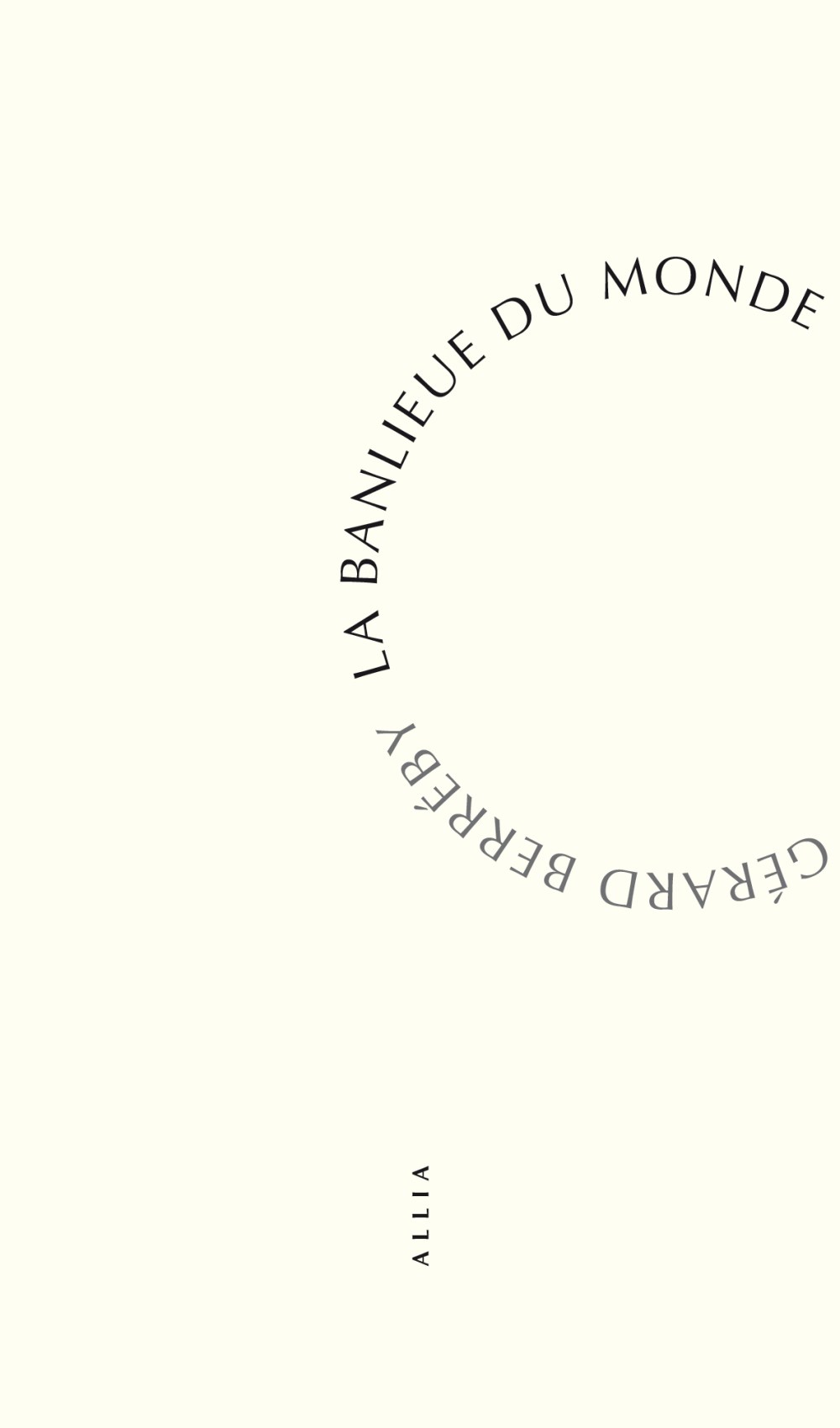
Gérard Berréby, La Banlieue du monde, Editions Allia, 2018, 100 pages
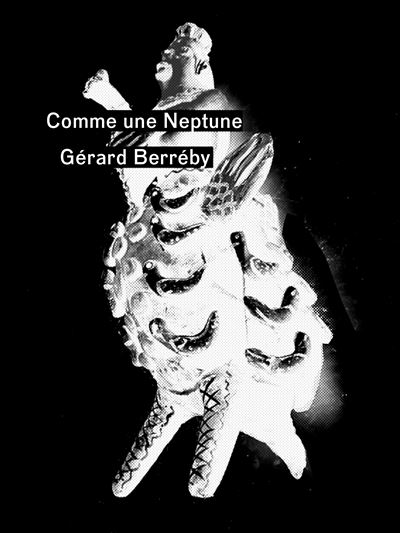
Gérard Berréby, Comme une Neptune, avec six photographies de Marisa Cornejo, Art & Fiction (Lausanne), 2018 – 400 exemplaires

Gérard Berréby, Joker & Mat, Editions Allia, 2016, 70 pages

Gérard Berréby, Stations des profondeurs, Editions Allia, 2010, 74 pages
Se procurer La Banlieue du monde
Se procurer Stations des profondeurs