
Avec le concept de foto povera faisant l’éloge des pratiques dites « archaïsantes », contre le mythe techniciste et la vulgate bressonienne de « l’instant décisif », Yannick Vigouroux, critique et photographe, a créé beaucoup d’émoi.
Collectif informel de photographes prônant le geste libre et l’enfance de l’art, foto povera n’a pas joué le jeu du marché de l’art, mais de la liberté punk et de la remise en question des valeurs dominantes en matière de beau.
Imprégné par la culture visuelle issue du rock indépendant et de l’underground, Yannick Vigouroux a refusé de se plier aux exigences esthétiques en vogue dans les milieux chics des années 1990, mettant le cap sur le plaisir du geste et de l’expérience hic et nunc, plutôt que sur les protocoles intellectualistes, trop souvent chichiteux.
Sans jamais craindre l’humour, foto povera a rappelé l’importance du corps, de la présence, de la matérialité du rien, du mouvement contre les idées fixes et la rentabilité des postures reconnues institutionnellement.
L’aventure de foto povera m’intriguant, j’ai souhaité interroger Yannick Vigouroux et ses complices, Jean-Marie Baldner, historien de la photographie, et Christian Gattinoni, critique, coauteur avec lui de plusieurs ouvrages de vulgarisation concernant l’histoire de la photographie aux nouvelles éditions Scala.

Yannick Vigouroux, qu’appelez-vous foto povera, pratiques pauvres ou même pratiques archaïsantes ? Pourquoi avez-vous été régulièrement l’objet de critiques concernant ces concepts ?
Yannick Vigouroux : « Archaïsant » est sans doute le terme le plus adéquat pour qualifier les pratiques qui m’intéressent depuis longtemps et caractérisent ma propre pratique artistique ; c’est le terme que j’avais choisi, sur le conseil de Michel Poivert, pour qualifier celles-ci lorsque j’ai soutenu mon mémoire de DEA d’histoire de l’art, sous la direction de Philippe Dagen à l’Université Paris 1 en 1999. Ce dernier est, entre autres, un spécialiste du « primitivisme » en peinture – c’est la raison pour laquelle je m’étais adressé à lui pour diriger mes recherches, m’intéressant beaucoup à Gauguin, aux Nabis tels que Pierre Bonnard ou Edouard Vuillard qui utilisaient d’ailleurs couramment le box 6 x 9 cm, dans un contexte amateur, mon boîtier de prédilection.
Avec, entre autres, le texte plus pédagogique de Jean-Marie Baldner, sous l’impulsion notamment de Sylvain Lizon et de Nathalie Giraudeau, alors directeurs du CPIF de Pontault-Combault, et de Francis Jolly, ce mémoire sous une forme très condensée est devenu le livre Les pratiques pauvres, du sténopé au téléphone mobile, en 2005 (Isthmes éditions, Scéren, CRDP de Créteil). Le terme « pratique pauvre », lors d’un apéritif préliminaire chez moi, a été proposé par l’éditeur privé, Michel Baverey, qui jugeait à juste titre cela plus commercial, moins universitaire…
« Foto povera » est quant à lui le nom du collectif créé avec Remi Guerrin (sur lequel j’avais écrit, à propos de ses sténopés déjà, pour le CPIF, justement, en 1998) pour nommer une exposition collective lors d’une carte blanche qui lui avait été donnée par le Centre photographique d’art de Sallaumines.
Comment définir « Foto Povera » ? C’est avant tout une réaction contre l’utopie techniciste qui habite la photographie depuis ses débuts, et ce qui lui est corrélé, comme la précision de l’enregistrement. Nous étions un certain nombre d’auteurs qui se sentaient, et dans mon cas toujours, en porte-à-faux avec le fameux « instant décisif » de Henri-Cartier Bresson, beaucoup d’autres diktats aussi comme le « format tableau » défendu par Jean François Chevrier… Peu de différence entre « réaction » et « révolution » en fait.
Le défaut des appellations « Foto Povera « ou « pratiques pauvres », c’est que si elles évoquent bien différents modes rudimentaires de prise de vue (le boîtier peut être une simple boîte de conserve ou canette percée d’un trou…), la restitution sur le papier peut être très « riche » : c’est le cas par exemple des tirages pigmentaires de Remi Guerrin ou de Bernard Plossu.
Nous voulions revenir à une photo plus sensible, dans le fond et dans la forme.
Tout cela s’est aggloméré, mais sans jamais se figer dans une nébuleuse joyeusement informelle et mouvante, que l’on a nommé « Foto Povera ».
C’était parfois un peu le bazar, théoriquement parlant, mais on y retrouvait nos petits quand même, du moins je crois.
Des courants libertaires traversaient, irriguaient parfois le groupe, il y avait des tensions, mais n’est-ce pas normal dans la vie d’un groupe ? Il y avait parfois une énergie proche du punk ou des premières radios libertaires (les gens nés de 1970 à 1980 et plus ont été davantage marqués par le scène musicale libertaire comme les Béruriers Noirs que par Henri Cartier-Bresson !)… On s’auto-fabriquait parfois, on était libres et proposait des tirages accessibles à tous. Des prix modérés, hélas, cela n’a intéressé personne ou presque, le collectionneur ne s’intéressant généralement qu’à ce qui lui donne de la valeur : 100 euros une œuvre n’intéresse pas la majorité d’entre eux. A noter que le premier catalogue de Foto Povera, devenu collector, était distribué gratuitement. D’ailleurs tous les livres que je fais – comme photographe et historien de la photographie, chez Scala, on y reviendra plus loin – sont vendus à des prix très accessibles qui excèdent rarement les 20 euros. 15 euros est pour moi un bon prix.
Ma première exposition importante, qui m’a alors attiré l’intérêt de Michel et Michèle Auer, et m’a fait rentrer dans leur « Encyclopédie internationale des photographes » (un DVD consultable à la MEP de Paris), je la dois à Alexandre Castant : j’avais présenté à Thessalonique, en Grèce, de simples photocopies laser de portraits faits au pola 600 noir et blanc, juste scotchées aux murs, accompagnées d’un enregistreur-lecteur posé sur le sol.
C’était une manière d’exister et de résister, au début des années 1990, au concept de la belle et grande photographie contrecollée sur alu si coûteuse ! Pour dire les choses simplement, j’étais très fauché et ne pouvait pas faire autrement… Alexandre Castant a été sacrément courageux et audacieux, d’exposer et publier mes vulgaires et médiocres photocopies ! Mais il n’est pas inculte, tout comme Christophe Mauberret, son ami d’enfance. Ils connaissent tous les deux très bien le son, et les codes de représentation des albums d’une certaine scène punck-rock, cold-wave, électro… Leurs fanzines produits avec les moyens du bord. Ils pourraient en parler mieux que moi ; par exemple Christophe parle de saturation limite de l’image dans son agrandissement important d’un négatif 6 x 6 cm généré par un Voigtland hérité de son grand-père.
Les couvertures des albums des Pixies (dont le graphiste très talentueux était Vaughan Oliver), par exemple, au début des années 1990, et ceux en général du label anglo-saxon 4A2 m’ont beaucoup plus influencé que Willy Ronis, que j’ai eu le bonheur de connaître, ou Robert Doisneau, ou Henri Cartier-Bresson ! J’avais follement envie de faire des images après avoir découvert les couvertures d’albums dits « cold-wave » ou « gothiques » (The Cure, Siouxie and the Banshees, Dead Can Dance, Cocteau Twins aussi…). L’impulsion venait du Rock, pas du monde de l’image mal représenté dans mon enfance et mon adolescence en Normandie. Quand je suis parti vivre à Caen, loin de ma chère campagne, je n’ai été soutenu que par l’ARDI-photographies de Caen, association à laquelle j’ai donné tous mes tirages et négatifs argentiques. Merci encore une fois à Bernard Chéreau, Gilles Boussard, et à tous leurs collaborateurs.
Il faut avouer que dans ce domaine les groupes de musique alternative post punk-rock français étaient assez faiblards visuellement, alors que les anglo-saxons créaient de vrais bijoux ! Tout cela allait de pair fin des années 1980, début des années 1990 : faire de la photo et pour certains des films était indissociable de Londres et New York. Paris était graphiquement en retard.

Pour la génération d’avant, celle qui a participé à Foto Povera, dont Bernard Plossu, je renvoie à la riche culture américaine de la Beat Generation. Je n’en parlerai pas bien car ce n’est pas ma génération, même si j’admire beaucoup Robert Frank, récemment décédé hélas. Je sais que cela angoisse beaucoup Bernard, mais les génies ne sont pas éternels.
Les photographes sont, pour les plus grands, de fragiles statues de cire.
C’est pourquoi j’adore écrire des histoires de la photographie avec Christian Gattinoni : on garde une trace de ces gens-là, les Plossu et autres, qu’on a la chance de connaître, on leur rend hommage sans j’espère les figer dans des concepts de marbre.
Jean-Marie Baldner : La force politique et esthétique de Foto Povera s’exprime dans le geste photographique, l’attention au corps, aux sens, aux temporalités du monde et de l’autre. Les mots de Bernard Plossu sur la capacité de voir le rien, de déclencher en-deçà de la pensée, dans le plaisir du geste me semblent dire au mieux l’expérience de Foto Povera. Pas de condamnation, pas d’exclusion, pas de hiérarchie dans l’image ou dans le sujet, dans la technique, mais la jouissance, révolutionnaire, de se prêter à l’écoute libre, à ce qui advient, sans limites, de jouer avec le doute et le flou, et de faire image de tout et de rien. Toujours avec humour.
Y. V. : je réagis à ce que vient de dire Jean-Marie, il y avait un côté joyeux et festif dans Foto Povera : on ne se prenait, je l’espère, pas trop au sérieux. Et l’humour avait bien sûr une place importante.

Pourquoi avoir mis fin au blog Foto Povera ?
Y. V. : Le sentiment d’être devenu le seul capitaine à bord, et de ne plus réussir à gérer les courants parfois contraires qui animaient le mouvement. J’ai eu la tentation de faire de ce collectif une association, quelque chose de formel. C’était peut-être une fausse bonne idée d’ailleurs ; l’objectif étant d’obtenir quelques subventions pour financer les projets des auteurs qui sont rarement rémunérés au titre des droits d’auteur et doivent trop souvent s’auto-financer. Mais guettait le risque de s’enfermer dans un certain conformisme, de figer les choses. Tant mieux donc si cela ne s’est pas fait !
Après, certaines personnes n’avaient rien compris aux principes fondateurs, et je me suis rendu compte qu’elles étaient là seulement par opportunisme… C’est le lot de tout collectif, je crois. Je ne parlerai pas de leurs travaux donc.

Vous avez donné régulièrement des conférences avec Jean-Marie Baldner. Quels en étaient les sujets ? Avez-vous fait école ? Qui étaient les membres de votre groupe informel ?
Jean-Marie Baldner : Les conférences – en fait il s’agissait plutôt de dialogues – avaient pour but de faire connaître des expériences de l’image, sans a priori, ouvertes à la sensibilité au monde, à l’écoute du regard et de l’autre sans visée artistico-commerciale. Après l’exposition « Foto Povera 3 : du sténopé au téléphone portable » en 2006, au Centre Photographique d’Ile-de-France à Pontault-Combault, et la journée-événement proposée par le Pôle national de ressources Image-photographie de l’académie de Créteil à la Maison Européenne de la Photographie et au CPIF, la première conférence a eu lieu en 2007 au Collège iconique animé par Serge Tisseron et François Soulages. Le sujet de cette première conférence-dialogue s’est construit, comme les suivantes, sur la base d’un panorama des travaux d’artistes, ouvrant la réflexion sur la notion de photographie « archaïsante », sur la place des sens, du corps et des temporalités dans l’acte photographique, sur la modernité et la dynamique politique des pratiques archaïsantes dans la société de consommation et de prédation contemporaine. Le sujet se réorganisait à chaque fois en fonction des nouvelles rencontres, des nouvelles découvertes, des questions du public qui nous amenaient à repenser ces pratiques.
Y. V. : Tout cela était en effet mouvant, jamais figé.
Les membres du groupe primitif de 2005 étaient Patricia Martin, Emma Géraud, Nancy-Wilson Pajic, Valérie Sarrouy, Stéphane Brochier, Bruno Debon, Yannick Vigouroux, Corinne Peuchet, Bernard Plossu, Christophe Mauberet, Véronique Felten et Christine Massinger, Emma Géraud, Janusz Stega, Juliette Méliah, Remi Guerrin, Thomas Baldner.
Il y eut sous l’impulsion de Rémy Weité une sorte de seconde vague en 2010 à la Médiathèque de Rambouillet avec Candido Baldachino, Bruno Dubreuil Mario Delage de Luget et Benoît Géhanne, Catherine Merdy, Jean-Luc Paillé, Yannick Vigouroux, Rémy Weité. L’enthousiasme de Rémy, et des artistes, a relancé la machine et je vous invite à découvrir le très beau petit film que Catherine Merdy a tourné. En voici le lien :
https://vimeo.com/16847186 fbclid=IwAR0s2oifZ2AFzQfWqbv_oZYhFE6Ieu7IyfcR6IM_QjPvWDWqYHLO-iRzCKE

Mais le collectif n’a cessé d’évoluer, et je pourrais citer aussi (désolé pour ceux que j’oublie), lors d’autres étapes dans des lieux publics ou des galeries privées : Ons Abid, Juliette Agnel, Cath. Ann., Driss Aroussi, Eric Bouttier, Jean-André Bertozzi, Philippe Calandre, Clara Chichin, Didier Cholodnicki, Marc Donnadieu, Patrick Gallais, Angéline Leroux, Karine Maussière, Clotilde Noblet, Eric Marais, Xavier Martel, Virginie Merle, Oscar Molina, Io Paschou, Oscura, Guillaume Pallat, Pierryl Peytavi, Corinne Rohard, Arnaud Zajac, Julie Vola…
A noter que j’inclus dans cette liste des artistes qui ont participé à des projets fotopoveresques intitulés parfois, non pas « foto povera », mais « Les images voyageuses », « Poladroid » etc. Des gens mal inspirés m’ont parfois conseillé de rebaptiser le collectif, ce qui n’était pas si pertinent à la réflexion, voire inepte. Ils ont pleinement participé aussi au coulage de foto povera et se reconnaîtront : écrire gratuitement un texte de plusieurs pages aussi pour un auteur décidant au dernier moment de se retirer du projet ou de montrer une autre série, au gré de son humeur versatile, ce n’est guère encourageant… ni reconnaissant.
A l’inverse, je tiens à saluer l’énergie de ceux qui n’ont pas exposé, mais ont organisé les choses : les regrettés Sandrine Derym, Bruno Maison, mais aussi Emmanuel Madec (très bon photographe, dont l’œuvre se poursuit aujourd’hui). Eux étaient et sont de vrais amis et m’ont laissé carte blanche. Sans me censurer. Les artistes peuvent parfois se révéler de terribles censeurs !… même au sein de Foto Povera.
Aux Etats-Unis, L’Opal Gallery, à Atlanta, dirigée par mon amie Constance Lewis qui elle-même a participé à différents foto poveras… et une exposition bien-nommée « Plossu/ Vigouroux, correspondances »…
Il y eu de nombreuses conférences pendant dix ans, animées avec Jean-Marie Baldner, Christian Gattinoni ou moi seul.

Y. V. : Les sujets étaient, mais Jean-Marie Baldner serait mieux placé que moi pour en parler, l’éducation du regard des enfants – les adultes étaient aussi concernés – via le sténopé ou les appareils jetables, voir le monde à une autre hauteur et distance de regard, fabriquer son propre appareil et donc construire librement sa vision.
J’ai fait très peu d’interventions, mais j’aimerais évoquer celle organisée autour du sténopé argentique avec l’artothèque de Vitré – une balade à vélo et au sténopé avait été organisée dans la même journée, merci encore Isabelle Tessier (directrice de l’artothèque) et Patrick Gallais -, une intervention ponctuelle auprès de prisonniers dans la banlieue nord de Paris… Un détenu m’a dit alors cette très belle phrase : « Oui, votre box, c’est comme ma cellule, je peux tout imaginer de l’intérieur ! »

J.-M. B. : Il y a eu au départ le travail de recherche de Yannick Vigouroux, les expositions au Centre Photographique d’Ile-de-France et à Sallaumines, le livre Les pratiques pauvres du sténopé au téléphone mobile dans la collection Pôle Photo. Puis un croisement d’événements et de pratiques :
– le projet sur le sténopé mené dans les écoles de Pontault-Combault avec Ilan Wolff mis en place par le CPIF et le professeur relais au CPIF ;
– les stages et formations destinés aux enseignants, aux artistes et aux personnels de la culture du Pôle National Ressources Image-Photographie (CPIF, Centre Régional de Documentation Pédagogique de Créteil, Institut Universitaire de Formation des Maîtres de l’Université de Créteil, Délégation Académique à l’éducation Artistique et à l’action Culturelle de Créteil et différents musées et centres d’art de l’Ile-de-France), piloté par Francis Jolly et animé par Sandrine Grosgeorge ;
– les cours sur l’image et la sensibilisation à la pratique photographique des étudiants, des stagiaires et des enseignants, notamment à la pratique du sténopé avec Guillaume Pallat en lien avec un enseignement de la géographie et de l’histoire d’en-bas, du quotidien et du peuple, de ses luttes et de ses rêves ;
– les projets menés avec des artistes dans différentes classes du Val-de-Marne et de la Seine-et-Marne.
Dans leurs dimensions théorique et didactique, les conférences ont essayé d’intégrer ces différents éléments. Il s’agissait de montrer, à travers les recherches des artistes et l’analyse des pratiques, à l’école et à l’université, notamment du sténopé, des appareils-jouets et du photogramme, comment la photographie, au-delà du regard, engage le corps et les sens ; comment, dans la pose longue du sténopé, dans l’attente du laboratoire, elle est une expérience du temps qui implique le corps, le geste, la sensation de la lumière et des ombres, l’attention de tous les sens à percevoir et à mettre en image ce qui advient là où il n’y a a priori rien à voir ; le plaisir et l’humour d’une requalification du quotidien et du presque rien, le plaisir d’ouvrir au monde le trou d’une aiguille ou de déclencher avant de penser. Et, par là-même, dans l’évocation des pratiques scolaires et universitaires avec des artistes, l’affirmation d’une pensée nourrie par le doute. En arrière-plan, il y avait l’humour, la liberté de voir et de sentir et la lecture partagée des textes de Georges Perec, Georg Simmel, Marc Augé, François Maspero, Jacques Réda…
Vous classez notamment le sténopé, la box, le téléphone mobile, dans les pratiques pauvres. Est-ce un éloge de l’amateurisme et de l’inventivité populaire ? Ne faut-il pas craindre les effets de mode, par exemple le chic négligé des Lomographes ?
J.-M. B. : Il est dommage qu’on lie aujourd’hui principalement le mot amateur, celui qui est ami, amoureux, à la négligence, au manque de professionnalisme, à la dévalorisation de la pratique. L’éloge de l’amateur n’est pas l’éloge de l’amateurisme. Bernard Plossu parle de photographier en riant, de découverte libérée du monde avec le bonheur de l’immédiateté, j’y ajouterais l’humour du doute, c’est là ce que nous entendons par « pratiques pauvres ». La fraîcheur du geste et du regard disqualifie immédiatement les effets de mode. Quand nous proposons des interventions d’artistes à l’école et à l’université, il s’agit non de faire l’éloge d’une inventivité populaire où tout se vaudrait, mais de cultiver la capacité à s’étonner, de se libérer de l’imitation. L’effet de mode n’est alors que la mesure de notre échec.
Y. V. : Depuis 2005, époque pas si lointaine mais qui semble aujourd’hui être la préhistoire de la photophonie, on est passé des rudimentaires images très pixelisées des fameux téléphones à clapet par exemple aux images très précises des smartphones et autres I-phones actuels, avec leurs applications intégrées permettant de créer des effets. Le problème est que trop d’effets est le piège de la facilité, de l’esthétisme… en cela de telles pratiques sont comparables à la lomographie, son « chic négligé ». Moi-même j’utilise actuellement à la prise de vue une application « vignette » qui produit des images dont le vignettage et la saturation des couleurs évoquent ceux du polaroid. Mais c’est un effet modéré. Tout est question de dosage. A partir de quel moment une image bascule-t-elle dans l’esthétisme ? Je ne sais pas très bien, je l’avoue, où se situe la frontière…

Le travail d’un photographe professionnel utilisant des techniques rudimentaires fait-il encore selon vous partie de la Foto povera, ou faut-il réserver cette dénomination aux œuvres proches de l’Art brut ?
Y. V. : Je rattacherais ce type de travail aux deux catégories. Foto Povera ne fait pas appel qu’aux pratiques amateures comme on le croit souvent. Par exemple Remi Guerrin a fabriqué son propre sténopé en bois, doté d’un dépoli identique à celui des chambres grand format professionnelles. Christine Felten et Véronique Massinger ont transformé une caravane en camera obscura… Rien à voir dans ces cas-là avec les pratiques des amateurs, même si parfois Remi pratique comme moi la box amateure 6 x 9 cm.
J.-M. B. : Foto Povera est une attitude et une disponibilité. Elles n’excluent en rien la professionnalité et l’utilisation d’appareils sophistiqués. En ce sens, Foto povera, tout en partageant des correspondances et des affinités avec l’Art brut, je pense par exemple à l’erreur, prise au sens large, humaine et matérielle, au rapport de l’esprit et du geste dans l’acte – et les pratiques photographiques avec des artistes dans les hôpitaux de jour, comme l’invitation au séminaire « Art et Thérapie » de Jean-Pierre Klein à la Halle Saint-Pierre ont bien montré ces convergences -, se situe dans une démarche différente.

N’y a-t-il pas dans la valorisation des pratiques pauvres l’exaltation du désir de voir, de la pulsion scopique coûte que coûte ?
Y. V. : Vous faites peut-être allusion à la pulsion scopique mortifère qui anime de manière exacerbée le personnage de principal de Peeping Tom (en français « Le voyeur ») de Michael Powell sorti en 1960 ?… (sourire). Rappelons le scénario : un jeune homme filme l’expression de terreur de ses modèle tandis qu’il les filme avec une caméra équipée d’une fatale lame stéréoscopique dont il a équipé son trépied.
Quel photographe n’est-il pas peu ou prou un voyeur ?… Ce n’est pas pour autant un criminel (sourire).
C’est vrai que les lomographes, animés d’une irrésistible pulsion scopique revendiquée aiment multiplier les prises de vue machinalement (« Don’t think, just shot », rappelons-le, est leur crédo), recouvrir, c’est ce que fait aussi Noboyushi Araki avec ses polaroids, pour constituer des « lomowalls », des murs d’images.
Je me reconnais personnellement dans cette tendance à propos de mes photos en noir et blanc de rues et de métros prises sans viser, au jugé, avec un minuscule Lomo LC-A. Catherine Merdy a fait partie de la lomographie, et ses diptyques je pense relèvent de cela (mais pas que de cela!) c’est la seule membre du collectif dans ce cas… En 2000 nous avons d’ailleurs exposé ensemble dans le projet « Lomo, vues de Paris » piloté par Samantha Barroero à la Fondation Gilbert Brownstone, à Paris.
Mais mes photos de bords de mer, les « Littoralités », à la box 6 x 9 cm, sont réalisées de manière beaucoup plus lente, voire légèrement contemplative (j’ai été beaucoup marqué par les travaux de Remi Guerrin lorsque je l’ai rencontré fin des années 1990, et par celui, pas fotopoveriste du tout, d’Eric Dessert à la chambre Linhof 4 x 5 inches, adepte du zone system théorisé par Ansel Adams, dont j’ai été l’assistant aux RIP d’Arles en 1992). Contrairement à une idée reçue fort tenace – il est si commode de ranger un auteur dans une seule catégorie, et marre des tiroirs ! – chez un même auteur peuvent cohabiter, en fonction de son humeur et du projet, des bonheurs et accidents de la vie, des tendances très différentes, voire opposées !… En apparence.

Vous êtes avec Christian Gattinoni l’auteur de quatre ouvrages publiés par Michel Guillemot aux nouvelles éditions Scala, La photographie contemporaine, La photographie ancienne, La photographie moderne, Histoire de la critique photographique. Comment avez-vous imaginé cette collection ? Comme une encyclopédie ou/et des manuels à l’usage des étudiants et des amateurs de photographie ?
Y. V. : Tout est né de l’immense humanité et générosité de Christian Gattinoni, dont j’ai été, en 1992-93 l’assistant à l’ENSP d’Arles, quand j’étais un simple étudiant. J’ai galéré après, il ne m’a jamais oublié, d’autres non – et je ne ferai jamais leur hagiographie -, et m’a toujours encouragé. Quand, en 2000, il m’ a proposé de co-écrire La photographie, 1839-1960, j’ai accepté sans hésiter…
J’avais écrit seulement un peu pour le magnifique Jardin des modes (merci encore à Alice Morgaine, la rédactrice en chef de cette très belle publication, un peu oubliée aujourd’hui hélas ; revue papier née dans les années 1920 de grand format). L’éditrice de Scala, Chantale Desmazières, souhaitait que ce style fluide, journalistique, non-universitaire, que je déployais pour le Jardin des Modes s’applique à sa publication dont la visée était la « vulgarisation ».
Rien de « vulgaire » dans la « vulgarisation », au contraire. Je me suis adapté avec Christian aux contraintes imposées par l’éditrice, que je remercie comme Christian. Rendre accessible pour un prix modique une publication sur l’histoire de la photographie : cela me motivait beaucoup. J’étais fébrilement impatient de concrétiser cela. Côté écriture, on en a bavé, avec Chantal, mais tant mieux. Notre premier opus est je pense de la vulgarisation dans la qualité. Irréprochable, je le dis sans fausse modestie. Je l’ai fait avec l ‘énergie de mes ancêtres, comme un tâcheron, un artisan de l’écriture. Comme un paysan cultive son champ, comme un ouvrier va serrer des boulons à l’usine. En serrant les dents, travaillant énormément.
Mais la concurrence d’internet a eu raison de mes petites ambitions, tous les étudiants et chercheurs en art vont depuis 2000 environ, désormais, sur Google, pour se renseigner, se documenter, ce qui tue une grande partie de l’édition papier pédagogique, et cela ne concerne pas que la photo.
Malgré tout, alors que je désespérais de cela, il y a au la renaissance des « éditions Scala » qui sont devenues, rachetées courant 2000, les « nouvelles éditions Scala ».
Le volume premier, à l’initiative de Michel Guillemot, un vrai professionnel et gentleman de l’édition, est devenu trois volumes, progressivement… quel bonheur !
Christian Gattinoni : Nous n’avons pas eu d’ambition encyclopédique, nous avons tenté de composer avec nos choix et les tendances de l’époque pour développer une culture photographique spécifique auprès du plus grand nombre, étudiants, mais aussi enseignants d’arts plastiques du secondaire et grand public. Si les deux premiers livres voyaient l’ensemble de nos choix déjà justifiés par le recul de l’histoire du médium, les deux derniers ont suscité entre nous plus de débats, et représentaient plus de risques pour tendre vers une certaine objectivité a minima.

Pourquoi le concept de photographie moderne fut-il parfois si mal compris ? Quels en sont pour vous les contours ?
C.G. : Ce livre est celui qui a représenté pour nous et notre éditeur Michel Guillemot, à qui nous sommes si reconnaissants pour son soutien toujours réaffirmé, le plus de recherches iconographiques. Nous le revendiquons totalement. En effet, cette période si proche de nous était à relire, ce que nous avons tenté à partir des monuments et des outsiders, notamment féminins (et nous assumons totalement la présence de Madame Yevonde en couverture avec son immense appareil photo). En France, le concept d’art moderne semble être encore difficilement appréhendé, et de ce fait l’équivalent de cette époque dans les pratiques argentiques n’est pas un concept suffisamment clair dans notre pays.
Y.V. : Dans l’histoire de l’art, mais pas celle de la photographie (en retard, nuance…), on parle couramment d’ « histoire moderne » : d’années dont la pratique de Gustave Courbet par exemple serait l’acmé. Pour la photographie, entre la fin historique de la Première guerre mondiale (la Révolution russe) et l’œuvre initiatique de Marcel Duchamp L’urinoir (1917), ce serait le début, jusqu’aux années 1960, l’après Seconde Guerre mondiale, marquant la nouvelle période de la « Photographie contemporaine » .
Tout cela est en décalage, photographiquement, et c’est un vrai problème avec ce qu’on enseigne à l’Université, la « période moderne » correspondant pour ces vieux caciques à une période antérieure à l’invention de la photographie ! Même si l’on connaît le principe physique de la photographie depuis l’Antiquité – Aristote entre autres en parle – la fameuse « camera obscura », ils refusent de qualifier cette période de « moderne » (1917-1960).
Il y a un immense décalage – mais c’est un lieu commun non ? – entre les lecteurs de nos livres et l’Université.
Est-on contemporain parce que l’on est né à partir de 1945 ?

Quels ajouts envisageriez-vous au volume La photographie contemporaine, publié en 2009 ? Pourquoi avoir classé dans ce livre dans la partie « Les adieux à l’image » Le Voyage mexicain (Contrejour, 1979) de Bernard Plossu ?
C. G. : Pour nos deux générations, ce livre de Bernard Plossu a été le marqueur d’une rupture avec la photo humaniste. Dans le chapitre, il est en co-présence avec des pratiques qui vont ouvrir cette rupture à d’autres esthétiques et à d’autres attitudes de façon tout aussi radicale. Plossu, comme beaucoup d’autres, fait partie de ceux qui, onze ans après notre publication, poursuivent leur œuvre. Nous restons à l’écoute de la création contemporaine et aujourd’hui un autre livre serait à refaire, avec d’autres participants qui se sont révélés depuis. Le concept de foto povera a été intégré dans les recherches que Marc Lenot a revendiquées comme la photographie expérimentale, un autre concept est né avec nos amis de la Biennale de l’Image Tangible (2e édition à l’automne prochain dans le 20eme arrondissent de la Capitale). Pour avoir expérimenté lors de mes dix dernières années d’enseignement à l’ENSP d’Arles les liens entre danse, performance et images, j’ai avancé le concept de photo performative. Le terme est importé de la linguistique avec les actes de langage, cette photographie en acte est le fait soit de plasticiens, soit de chorégraphes et performers.
Y. V. : Bernard Plossu est présent à la fin de La Photographie moderne. Il est selon moi comme Arnaud Claass, et Magdi Senadji, Jean-Philippe Reverdot, dans cette frontière incertaine entre « photo moderne » et « photo contemporaine ». Ne parlons peut-être pas trop de ces frontières si floues… Conceptuellement, c’est souvent douteux.
La photographie ancienne fait l’état des lieux des premières pratiques photographiques. Qu’invente-t-on aujourd’hui, alors que les procédés anciens sont repris par nombre d’artistes cherchant à rapprocher leur façon de concevoir le médium du métier d’art ?
Y. V. : Pas de problème pour moi. On utilise les pratiques anciennes si l’on veut pour faire des images « contemporaines »… Dans « Foto Povera », nombre d’artistes sont revenus aux origines du médium, de sa perception.
Christian a exposé des artistes dès 1989 qui revendiquaient, comme Ilan Wolf pratiquant les sténopés argentiques, entre autres, une filiation avec la photographie ancienne, sous le titre gentiment provocateur « Les nouvelles pratiques anciennes » . Ce catalogue a été l’un des fondements de ma réflexion sur les « pratiques archaïsantes ».
Mais, avec l’arrivée du numérique, et avec les artistes ayant participé à Foto Povera, tels que Juliette Agnel et Pierryl Peytavi (et moi-même depuis 2007) a émergé une nouvelle forme de sténopé. Les modes opératoires ne sont pas tous les mêmes. Juliette place un boîtier numérique derrière un caisson en bois qu’elle a fabriqué et qui se substitue à l’objectif. Pierryl substitue son bouchon en plastique percé à l’optique. Les images devenaient plus fluides, inscrite dans un mouvement, un flux.
En ce qui me concerne, j’ai utilisé dans un premier temps un appareil Sony-Cybershot compact appartenant à un ami, tombé accidentellement par terre ; l’optique baillait, un collègue de travail l’a arrachée et l’idée de lui substituer le couvercle percé d’un trou d’aiguille d’un capuchon en plastique de film 135 lui est venue : et miracle c’était le bon diamètre ! Cet appareil étant tombé en panne au bout de deux ans, j »ai éprouvé le besoin irrésistible de poursuivre mes recherches formelles, et j’ai sacrifié l’un de mes propres appareils compact : j’ai arraché l’optique avec une pince. Cela m’a fait mal et beaucoup de bien à la fois : il s’agissait, de façon presque rituelle, de faire violence à la technologie contemporaine.
Dans tous les cas, quel que soit le mode opératoire, les images obtenues sont très douces, floutées, sans arêtes visuelles. Mais c’est aussi le propre des sténopés argentiques, rien de nouveau à ce niveau-là ! Ce qui me semble intéressant, c’est que l’on ne passe pas par un des nombreux filtres numériques mis désormais à notre disposition. Le flou est obtenu à la prise de vue, numériquement certes, mais dans une certaine tradition straight de la photographie. Le capteur s’est tout simplement substitué au film argentique.

Vous travaillez actuellement à un cinquième ouvrage, Fictions documentaires. Comment le bâtissez-vous ?
Y. V. : Une amie m’a dit de manière très pertinente lorsque je lui ai parlé du projet : « Fictions documentaires relève de l’oxymore »… Oui, c’est juste, et pourquoi pas ? J’aime les paradoxes, voire les contradictions. Et suis toujours désireux, quelle chance j’ai, d’écrire avec Christian Gattinoni et Jean-Marie Baldner, ceux que j’aime nommer mes « binômes d’écriture ».
C. G. : Ces nouvelles activités de création se situent entre deux formes d’approche des situations politiques ou idéologiques, à travers une action de terrain en lien à un groupe ou à une communauté. Nous avons abordé ces pratiques selon cinq attitudes : Garder traces, Négocier l’image, Refaire l’histoire, Donner lieu, Rendre corps et Post produire l’image. Cette recherche accompagne et complète l’action de terrain du GRAPh, membre du réseau Diagonal qui depuis quatre ans organise le Festival du même nom dont je suis le conseiller artistique.
Comment comprenez-vous, Yannick Vigouroux, l’expression « photographie performative » évoquée précédemment ?
Y. V. : Mes vagues souvenirs d’étudiant en lettres modernes à Caen (1989-90) me renvoient à la notion « d’agir ». Une « photo actante, qui agit ». J’aimerais que ce soit le cas de toutes, positivement. Que les photos que l’on perçoit nous influencent dans le bon sens… nous aident à vivre. Mais Christian a répondu mieux que moi à cette question.

Yannick Vigouroux, poursuivez-vous votre propre œuvre de photographe consacrée pour une bonne part à la question du littoral ? Une exposition de vos travaux récents est-elle prévue ? Christian Gattinoni, quels sont vos projets personnels les plus récents ?
Y. V. : je n’aime pas beaucoup la notion d’ « œuvre » ; je fais un travail, en bon artisan, je l’espère.
Non, pas d’exposition prévue. Je travaille désormais surtout, toujours sur les bords de mer, au polaroid – le Fuji Instax Wide japonais pour être précis –, le coronavirus ayant tout retardé, sinon tout annulé, pour moi et les autres… Régulièrement, l’ARDI-photographies de Caen, que j’ai déjà cité, expose mes travaux anciens. Donc pas de projet dans l’immédiat, mais je ne me plains pas, j’aime mettre mon écriture au service des autres.
Et je ne vais pas conclure ainsi, sur une note pessimiste, car mes amis continuent à faire de belles photos, en dehors de tout diktat. Ces ex, entre autres, de Foto Povera, sont-ils fous ? Ils sont passionnés en tout cas, et continuent de faire de belles images sensibles. Ils sont parfois marginalisés par le milieu de l’art, alors achetez leurs livres et leurs tirages, exposez-les !
C. G. : Mon travail sur la mémoire de la seconde génération de la déportation s’est poursuivi à travers le projet franco-allemand, avec un workshop destiné aux lycéens « Photographier contre l’oubli », commandité par le Musée mémorial des Enfants du Vel d’hiv, dans le cadre de l’opération « Mémoires Croisées », un site est en préparation. Dans ces moments j’ai produit aussi les diptyques de ma série Anges noirs, dont je prépare une micro-édition.
Propos recueillis par Fabien Ribery

Christian Gattinoni et Yannick Vigouroux, La photographie contemporaine, nouvelles éditions Scala, 2009, 128 pages
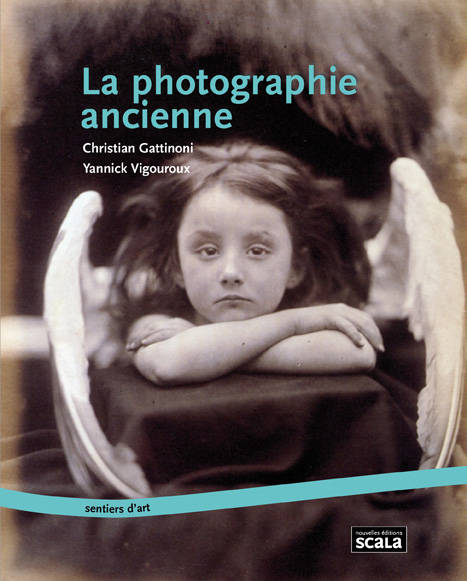
Christian Gattinoni et Yannick Vigouroux, La photographie ancienne, nouvelles éditions Scala, 2012, 128 pages
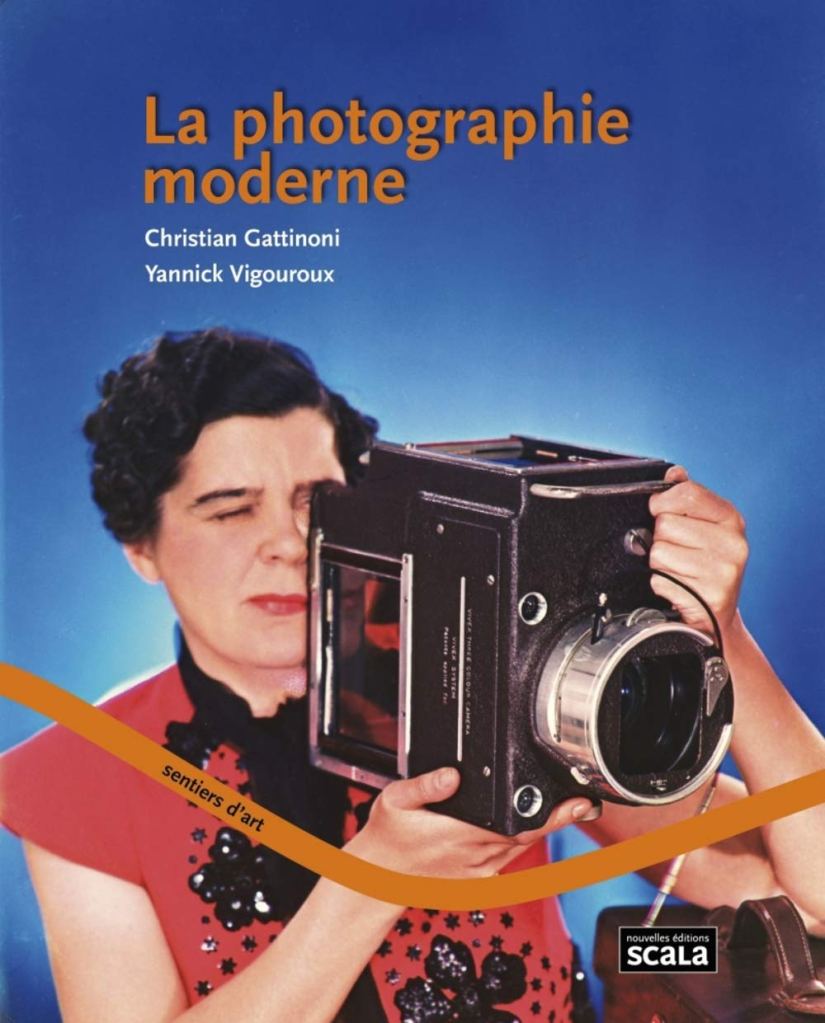
Christian Gattinoni et Yannick Vigouroux, La photographie moderne, nouvelles éditions Scala, 2013, 128 pages
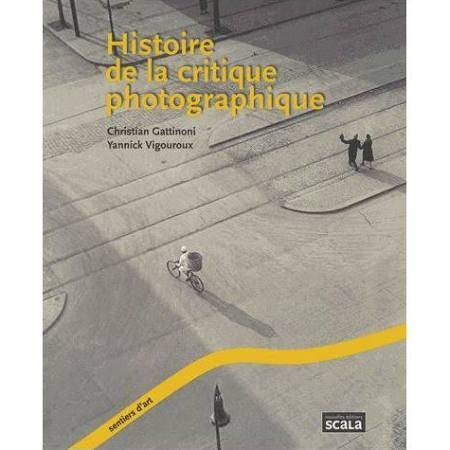
Christian Gattinoni et Yannick Vigouroux, Histoire de la critique photographique, nouvelles éditions Scala, 2017

Yannick Vigouroux, Marseille cabanon, textes Jean-Marie Baldner, Les Editions de Juillet, 2015, 80 pages
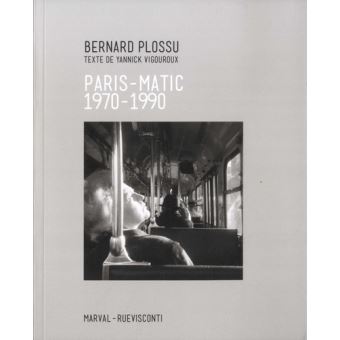
Yannick Vigouroux est aussi l’auteur du texte accompagnant le volume Paris-Matic, 1970-1990, de Bernard Plossu, éditions Marval-rueVisconti, 2020 (article à lire dans L’Intervalle)

Se procurer La photographie ancienne
Se procurer La photographie moderne
Se procurer La photographie contemporaine
Se procurer Histoire de la critique photographique