
Depuis Avenue de France (Gallimard, 2001), la romancière Colette Fellous conçoit des livres où la photographie occupe une place à part entière dans son processus d’écriture.
J’ai souhaité l’interroger à ce propos, et déployer avec elle l’ensemble des significations attachées à l’utilisation des images dans un texte en prose.
A son arrivée à Paris, Colette Fellous, jeune femme venue de Carthage et du bleu méditerranéen, participa au séminaire de Roland Barthes, rue de Tournon.
On entend ici le lointain délicat du grain de sa voix.

Le titre de votre livre La préparation de la vie, publié en 2014, est une évocation directe de celui des cours et séminaires de Roland Barthes au Collège de France (1978-1979 et 1979-1980), La préparation du roman. Quelle a pu être l’importance des romans dans votre éducation et votre éveil à la vie ?
Puisque vous évoquez Roland Barthes, il me revient une phrase de lui que j’emporte toujours avec moi, comme si sa voix et sa présence me guidaient encore, comme s’il était près de moi. « Construire un roman est un art de vivre. » C’est aussi ce que nous dit La préparation du roman. Je ne sépare pas celle qui écrit de celle qui vit. Tout devient scintillant dès qu’on est dans l’écriture d’un livre, tout ce qui vous arrive peut y entrer. Cet art de vivre devient un art de trier, de capter, de mixer les choses, de leur donner une nouvelle puissance. Depuis toujours, les romans ont habité ma vie et mes maisons, je pensais depuis que j’étais enfant et même depuis mes premiers livres d’école que les personnages de tous les romans que je lisais étaient des amis, de vrais amis. A partir du moment où on posait ses yeux sur eux, ils entraient dans notre vie intime, je me disais que c’était le secret de la lecture. Je les emportais tous avec moi eux aussi, ces personnages. Je le fais un peu moins maintenant. Je m’attache davantage à des livres atypiques, aux voix et aux formes inédites, qui risquent leur vie on pourrait dire.
Définiriez-vous vos livres comme des romans autobiographiques ?
Oui, on peut les appeler comme ça puisque je pars toujours de l’autobiographie, du moins depuis Avenue de France, mais je l’élargis en lui donnant une forme romanesque. Ce qui me pousse à écrire, c’est toujours la recherche d’une forme. Sans invention de forme, je ne peux rien raconter. Ma propre histoire ne m’intéresse pas si elle ne passe pas par la création d’une structure romanesque. Alors, roman autobiographique, ce serait ce qui se rapprocherait le plus, oui. Mais j’aime aussi les appeler tout simplement : livres.

La présence de la photographie dans votre œuvre depuis Avenue de France (2001) est-elle une façon de créer un jeu, un décalage, entre l’écriture et l’image, d’introduire d’autres possibilités de fictions, pour vous qui êtes une amoureuse des histoires, d’autres manières d’entraîner l’imagination du lecteur ? Considérez-vous les photographies comme des preuves ou des confirmations ? Une façon d’arrêter ou relancer le flux des mots ? Des dépôts de temps ? Un pendant de vérité quand les phrases peuvent être trompeuses ? Des moments de nostalgie ? Leur statut n’est-il pas fondamentalement hybride, multiple ?
Oui, c’est tout cela à la fois, vous avez raison. Au début, en composant Avenue de France, je ne savais pas que j’écrirais une série de six livres dans lesquels la photo joue un rôle essentiel. En fait, de nombreuses photos qui sont dans Avenue de France ont été prises lors d’un court voyage que j’avais fait à Tunis à l’âge de 26 ans, neuf ans après mon départ pour Paris. Je photographiais en somnambule des trajets que je faisais dans la ville quand j’étais enfant, les portes d’immeubles, les balcons, les enseignes, les détails architecturaux, les trottoirs, la vue sur la rue à partir des fenêtres de ma maison, etc. Je voulais retrouver ce que j’avais ressenti enfant, comment je posais mes yeux sur le réel, quelque chose m’avait toujours échappé et je voulais le retrouver, alors clic, je prenais une photo en me disant que c’est dans la photo que je trouverai. Et ce n’est que vingt-cinq ans après, pour écrire Avenue de France, que je suis allée rechercher dans mes papiers la pellicule de ces photos. Je ne les avais jamais développées, j’avais juste des planches contact. En les posant dans le texte, en leur donnant leur propre voix, c’est-à-dire en n’étant pas illustratives, je créais un jeu entre ce qui était écrit et ce que les images laissaient voir, je jouais avec le temps, je le déployais, le dépliais, je pouvais passer d’un siècle à l’autre en une phrase, ça ne me gênait pas, j’étais à l’aise. Je vois l’ensemble comme une danse où chacun est libre de raconter son histoire quand il veut. Le texte, l’image et le lecteur. Une photo, c’est un morceau concret du temps, c’est le temps devenu un objet. Plus on regarde une photo, plus on retrouve les sensations, les hors-champs, les choses invisibles, les émotions. C’est à partir de tout cela que j’écris. Pour retrouver quelque chose que peut-être je n’avais pas bien vu, ou que j’ai oublié de voir. La photo est un espace multiple, elle n’appartient pas seulement à la grammaire de celui qui écrit, elle est ailleurs, quelqu’un qui était à côté, au moment où je l’ai prise, a peut-être vu la même chose. C’est ce qu’on se dit parfois. Elle donne une grande liberté au récit, elle le fait danser. Alors, dans ma tête je dis : chacun fait les gestes qu’il veut, on danse ensemble le temps d’un livre, on n’est pas séparé, et c’est déjà beaucoup.

Les images que vous introduisez dans vos textes ne sont-elles pas simplement des biographèmes ? Vous citez notamment ce passage de Sade, Fourier, Loyola, de Roland Barthes : « Si j’étais écrivain et mort, comme j’aimerais que ma vie se réduisît, par les soins d’un biographe amical et désinvolte, à quelques détails, à quelques goûts, à quelques inflexions. Disons à des « biographèmes » dont la distinction et la mobilité pourraient voyager hors de tout destin et venir toucher, à la manière des atomes épicuriens, quelque corps futur, promis à la même dispersion. »
Cette phrase est très étrange, j’y reviens toujours quand il s’agit d’écrire un livre. Elle donne l’autorisation d’être à la fois soigneux et désinvolte, c’est une merveille de liberté et ça me convient tout à fait. On n’est pas obligé de tout dire, c’est cela que ça veut dire. Une vie, ce n’est pas toute une vie. Ce sont surtout des fragments, des moments, des secousses, des plaisirs, des étincelles. Il n’y a pas toujours de cohérence à trouver. En tout cas, les choses se placent toutes seules, elles voyagent, elles prennent plaisir à raconter. J’aime aussi quand Barthes parle d’atomes épicuriens. Les images que j’invite dans le livre ressemblent en effet à ces atomes épicuriens, qui viendraient toucher (frôler) le cœur du récit et peut-être le cœur du lecteur.
Le plaisir que vous prenez très certainement à imaginer l’ordre, la taille, et le choix des images n’est-il pas similaire à celui d’une fleuriste imaginant une composition florale ?
C’est drôle que vous parliez de fleurs, j’ai l’intention d’écrire un jour un livre qui s’appellerait Quelques fleurs. Raconter une vie à partir de bouquets. On les verrait ces bouquets, ils scanderaient le livre. Mais c’est loin d’être fini. Et aussi Quelques fleurs, c’était un des parfums de ma mère, un parfum signé Houbigant.

Les images sont-elles une façon, par les pointes de désir dont elles sont porteuses, de se désennuyer de la prose quand celle-ci devient un confort ?
Peut-être pas désennuyer, mais elles permettent un trajet, on bifurque, on s’échappe et on revient, on essaie de comprendre pourquoi cette photo est à telle page, on relit, on imagine, on regarde encore, c’est un voyage supplémentaire, comme un secret qu’on ne dit pas, qu’on laisse entendre. Pointes de désir, c’est aussi leur fonction, oui
Dans Nadja et L’Amour fou, André Breton avait souhaité remplacé des descriptions qu’il pouvait juger fastidieuses par des images. Il semble que chez vous, au contraire, les photographies apparaissent comme une saveur supplémentaire, et non des moyens de substitution. Que pensez-vous de cette analyse ?
Oui, bien sûr, c’est une bonne analyse, parce qu’elles contiennent toujours des émotions, des reflets, des lumières, des nuances, un moment particulier du jour, un rituel collectif, comme dans Pièces détachées la photo où on voit des passants de dos venir regarder la mer à la fin du jour à Sidi Bou Saïd. C’est comme une prière, ou un chant collectif. Tous les jours à la même heure, au même endroit, c’est pareil, ils sont là de dos et ils regardent la mer. Alors je les invite parce que ça dit quelque chose du lieu, même si on ne le connaît pas. Une chose aussi qui est différente : dans Nadja ou même chez Sebald, les photos montrent ce qu’on vient d’écrire. Ici, cela arrive parfois, mais en général, non. Au contraire, c’est comme si on pouvait tourner la tête et voir ce qui est hors cadre, hors récit, hors livre.

Les images que vous choisissez proviennent de sources très différentes, de vos archives personnelles, de la BNF, de la cinémathèque… Avez-vous l’âme d’une collectionneuse ? La pensée du montage et de l’image dialectique telle qu’envisagée par le philosophe allemand Walter Benjamin a-t-elle pu vous inspirer ?
Collectionneuse, je le suis certainement. J’ai une collection d’anciennes cartes postales de Tunisie, mais d’une manière générale, j’aime l’idée de collection, de série, de choses qu’on doit encore trouver. J’aime aller à la recherche d’un objet, mais sans le chercher précisément. C’est la rencontre qui m’attire, le hasard, la flânerie. Je flâne dans ma mémoire comme dans une ville ou dans un grand magasin. Parfois je reconnais, d’autres fois je découvre, et c’est le même délice. Ensuite, le temps du montage et du mixage, du glissement d’un thème à un autre, d’un lieu à un autre, d’un temps à un autre, devient le vrai travail, le vrai plaisir.

La plupart de vos images sont-elles désormais prises avec votre téléphone portable ? Sont-elles de nature épiphanique ?
J’aime beaucoup la vitesse du portable, sa légèreté, sa liberté. Ce sont des notes, ces photos, de petits moments que je veux retenir, des « Haïkus » ou des épiphanies, oui.
Vous avez beaucoup travaillé sur l’œuvre de Georges Bataille. La revue Minotaure a-t-elle compté pour vous ?
C’était une revue culte, ouverte sur la modernité et traitant aussi de la mythologie, de l’Antiquité, mêlant le travail des peintres, des poètes et des philosophes. Bataille et Breton, ainsi que Tzara, étaient les initiateurs et quand je suis arrivée à Paris, en 1967, j’étais très influencée par le surréalisme tout en guettant les nouveaux courants littéraires et en m’imprégnant d’eux. Je me souviens de Soleil pourri, un très beau texte de Bataille, sur la corrida et sur la mythologie. De l’éditeur Skira, j’ai ensuite adoré la collection Les sentiers de la Création qui laissait aussi une large place à l’iconographie. Des textes magnifiques ont été publiés dans cette collection, comme La fabrique du Pré de Francis Ponge, Roue Libre de Pierre Alechinsky, ou L’empire des signes, de Roland Barthes.
Avez-vous lu La Chambre claire, de Roland Barthes, dès sa parution en 1980 ? Qu’en avez-vous pensé ? La lecture de cette œuvre a-t-elle déterminé votre façon de penser la photographie ?
Oui, bien sûr, j’ai lu La chambre claire dès sa sortie, et cette lecture était d’autant plus poignante que Roland Barthes venait de mourir. C’est un livre qui m’a beaucoup marquée, surtout lorsqu’il décrit la photo de sa mère enfant dans Le Jardin d’Hiver et qu’il ne montre pas la photo. Barthes nous a appris à travailler à partir de nos doutes, de nos silences, de nos pannes. En ce sens, il m’a libérée. Mais c’est quand je l’ai relu plusieurs années après que j’ai saisi la force secrète de ce livre. Il est désarmant. Et il me fait aimer Barthes sans restriction.
Qu’entendiez-vous d’inédit au 6, de la rue de Tournon, à Paris, à la fin des années soixante-dix ?
Tant de choses et tant de formes nouvelles. D’abord, le lien entre le professeur et les étudiants. Un lien d’amitié et de délicatesse, un engagement commun qui n’avait jamais à être prouvé. Notre présence, nos corps, notre écoute suffisaient. Tous ceux qui étaient là avaient signé un pacte avec Barthes et on ne cherchait jamais à savoir quel était le pacte de l’autre. Ce qui était inédit, c’était cette façon de s’emparer des textes et de leur donner une vie nouvelle, de les sculpter à nouveau, de les transformer pour les rendre à leur vérité. Il y avait aussi cette grande nouveauté de pouvoir glisser des choses très personnelles, très quotidiennes dans l’étude d’un texte. Il nous a autant appris à lire qu’à vivre. C’est lui aussi qui m’a poussée à écrire et ça ce n’est pas rien.

Que reste-t-il de vos lectures de Tel Quel ? Un reclassement de la bibliothèque ? Un compagnonnage lointain ou proche avec Philippe Sollers ?
Ce n’était pas seulement lire Tel Quel que j’aimais, c’était aller aux Conférences à St-Germain. J’avais dix-neuf ans et je venais écouter Derrida, Kristeva, Sollers, Pleynet. Il y avait une effervescence joyeuse qui ne ressemble pas à ce qu’il en reste aujourd’hui. Il y avait aussi Les Cahiers du Cinéma, à la même époque, qui publiaient des textes étonnants, qui nous faisaient comprendre de façon moderne toute l’histoire du cinéma. Le cinéma et la littérature étaient, là encore, un art de vivre, de se mouvoir dans la ville, d’avoir confiance en l’avenir. Tout était neuf, tout était à réinventer.

Votre ambition poéthique est-elle tout entière dans cet incipit du livre Avenue de France : « Le monde m’a été donné, je dois le rendre. » ?
Oui, c’est finalement cette phrase qui unit les six livres de cette série autobiographique. Il faut entendre « je dois le rendre » dans tous les sens du verbe. Le sens premier, le rendre comme on rend une invitation. Le rendre, parce qu’un jour il faudra vraiment quitter la vie. Et aussi le rendreme un peintre ou un artiste, le décrire, le mettre en musique, le montrer, le photographier, l’aimer.
Propos recueillis par Fabien Ribery

Colette Fellous, Avenue de France, Gallimard, 2001
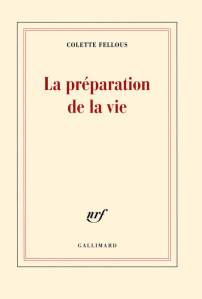
Colette Fellous, La préparation de la vie, Gallimard, 2014, 210p
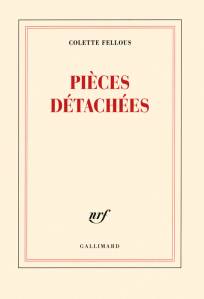
Colette Fellous, Pièces détachées, Gallimard, 2016, 168p

Acheter Avenue de France sur le site leslibraires.fr
Acheter la préparation de la vie
Un immense merci à Colette Fellous pour la transmission de ses images