
« Je ne peindrai donc pas Baudelaire pour les menus pions de l’échiquier, mais seulement pour les cavaliers ou les fous, qui peuvent en connaître : car il faut au moins que le pion soit soutenu d’une bonne pièce pour faire échec à la reine ou au roi. Ainsi j’ennoblis le jeu, avant de m’y mettre. » (André Suarès)
J’ai découvert, alors que je séjournais souvent en Italie, André Suarès (1868-1948) avec Le voyage du Condottière (1932), puis à travers les textes enthousiastes de Marc-Edouard Nabe, notamment dans ses journaux-fleuves, drôles, méchants et délirants.
« Je languis après Venise. J’en voudrais sortir, quand j’y suis. Et quand je n’y suis plus, je brûle d’y être. Venise est dangereuse, Venise est enchanteresse. Avec les barques de Chioggia, aux voiles immenses, d’azur, de soufre et de pourpre, plus bleues, plus rouges, plus triomphantes que les galères pavoisées, au retour de Don Juan, après la victoire de Lépante, je suis rentré par le vent du sud, qui a le souffle ardent de la nostalgie. »
Des publications récentes me rappellent le nom de ce grand polémiste, essayiste et poète à la langue brûlante, d’abord l’ensemble de ses superbes écrits sur Baudelaire (son ami Paul Claudel en fit l’éloge) aux Editions des instants, Vues sur Baudelaire, puis chez Gallimard – il fut, selon Gide, « un des piliers de la NRF » – une anthologie de ses voyages maritimes, Ports et rivages, et sa correspondance avec Gabriel Bounoure menée entre 1913 et 1948.
Suarès célèbre en Baudelaire le poète total, ardent et grave, pécheur sublime, « trop chrétien pour être cynique et trop peu pour être humble. »
Chez Suarès, lorsqu’il est à son plus haut niveau d’analyse et de voyance, chaque phrase compte, chaque phrase est une ordalie.
« Un sentiment original est si rare qu’il blesse le sens commun. »
Baudelaire lutte contre la chute, est damné, se bat contre la société basse.
« Il a compris les temps nouveaux et les a détestés. (…) Il a du Russe, et de la songerie frissonnante sous le ciel de Pétersbourg. Il a de l’Anglais, rongé de spleen. Il a du vieil Italien, chroniqueur du bronze. Et plus encore de l’Espagnol, à la Goya. Ce poète de Paris est un homme de l’Europe. (…) Le mépris de Baudelaire pour son temps, pour la tourbe et pour l’élite, est si roide, qu’il préfère le scandale à la louange publique. Il aime mieux faire horreur aux gens, que leur être semblable. Il s’étudie à différer. Moins une affectation, en lui, qu’une motion de nature. »
Baudelaire fut harcelé par le manque d’argent, et bientôt la misère.
A moins de quarante ans, il songe à se tuer.
« Le plus beau trait de Baudelaire est d’avoir assuré e bénéfice de la solitude et de la liberté à son art et à ses œuvres, sans en avoir les moyens. Ses tortures ont été sa rançon. Au fond, en dépit de ses geôles et de ses chaînes, il n’a jamais écrit une ligne ni pour plaire ni pour gagner de l’argent. Chaque heure de cette liberté spirituelle, il la lui fallut payer par un combat plein de blessures et de déchirements. La solitude de sa pensée n’était qu’au prix de ses singularités, du mauvais renom, de la défaveur publique et de la maladie, sans compter l’oblique compassion des philanthropes, qui dure encore. »
Il aimait au suprême les plaisirs de la conversation, mais avec qui parler ?
Il invita au voyage, et ne quitta que très rarement sa chambre de l’île Saint-Louis, ou pour Honfleur quelquefois, puisque sa mère y réside, et la désastreuse Belgique.
« On est loin, avec lui, de la poésie oratoire, de cette éternelle déclamation qui, ayant fait le choix d’un sujet, le tourne en plaidoyer ou en réquisitoire, en sermon ou en quelque entretien familier. Baudelaire n’est poète qu’à l’occasion de ses émotions, et presque de ses crimes. Ce qu’il appelle les fleurs du mal, c’’est la flore secrète des sentiments, sous le climat de l’imagination. »
Fils de Joseph de Maistre et de Edgar Poe, ayant compris mieux que personne Wagner, Corot et Manet, le poète est à quarante-cinq ans un être ravagé, un vieillard, un déchet.
« Baudelaire, cet homme torturé d’être ce qu’il est, et qui ne voudrait pas être autrement, a toute l’inquiétude de l’insomnie moderne. Il fait penser à une Thérèse de l’abîme, à un moine d’Espagne maudit sous la coule et le scapulaire. Quelle âpre intelligence il porte dans le sentiment ! Quelles odeurs pénétrantes il exhale, de chaudes tubéreuses, d’iris noirs, d’encens funèbre et de santal ! Quel étrange parfum d’Orient est répandu dans ce château d’automne et l’ombre occidentale où Baudelaire, à l’orgue, élève son plain-chant d’angoisse et ses proses de péché ! »
Et ceci, qui m’exalte, en conclusion de son article paru le 25 décembre 1911 dans La Grande Revue : « Baudelaire est plus près de Pascal et des grands solitaires que personne. La guerre de son destin contre sa nature intérieure, la douleur d’être vaincu et la nécessité d’en passer par là pour vaincre un monde méprisé, l’ont fait poète. Et d’en avoir créé une image sans doute éternelle, voilà son génie. Là-dessus, on peut laisser les chenilles de Sorbonne compter leurs pieds, et chercher le ver dans la poussière ailée du Grand Paon Nocturne. »
Chez Suarès, pour qui la poésie est une mystique – il pense aussi à Keats, mort à vingt-six ans -, le lyrisme rencontre la sécheresse du jugement le plus sûr, faisant de lui avec Diderot, Baudelaire et Breton l’un des plus grands critiques d’art.
« Ainsi, qu’ils le veuillent ou non, tous les poètes sont issus de Baudelaire, à quelque degré que ce soit. Walt Whitman, seul excepté : mais celui-là n’est pas un artiste : c’est un prophète, une force qui parle, pour lâcher autant de sottises et de lieux communs à rebours que de prêches sincères, d’hymnes à la nature et de bonnes paroles ; une espèce d’orateur sacré, sa foi étant, d’ailleurs, aussi vulgaire, aussi primaire, aussi vague que sa pensée. Walt Whitman n’est guère plus que le douanier Rousseau de l’effusion lyrique. Je me fais une autre idée de la poésie et du poète. Apollon eut criblé de flèches ce Marsyas démocrate et l’interminable souffle, l’insupportable haleine de sa mélodie. »
Mais André Suarès, c’est aussi l’amour de la mer, de la Bretagne – il y a chez lui un tropisme celte, l’écrivain se donnant même une hérité bretonne fictive, souhaitant un temps être enterré sur le tertre de Landévennec – et de la Provence – il est né à Marseille -, qu’il lie dans une même intensité, les ports de Brest et de Toulon, ainsi que leur rade, aimantant ses pas.
Ce sont d’ailleurs pour lui « deux sœurs jumelles, comme Héraclite et Démocrite sont les jumeaux de l’âme grecque ».
Très proche d’un frère marin décédé jeune brutalement (leur correspondance est abondante), l’auteur de Hélène chez Archimède (Gallimard, 1949) se considère, loin du snobisme du tout-Paris littéraire qu’il rencontra et dont il fit le portrait, « homme de la mer avant tout ».
Il écrit ainsi dans Le Livre de l’Emeraude (1902) : « Je vais au bord le plus lointain de la terre, là où la Bretagne s’enfonce dans la mer, maintenant que tous les hommes et ses propres fils se précipitent vers les lieux de la foule ; je leur tourne, comme elle, un dos de granit. »
Il croise à Beg-Meil (Finistère) un mendiant, et l’on songe à Germain Nouveau sous un ciel à la Vernet : « Il est droit comme un jeune homme. Ses loques sont ajustées, et bien serrées aux chevilles : il en paraît plus nerveux, et les jambes plus fines. La couleur de ses vêtements est si usée, qu’elle flotte indistincte du gris à l’ocre. Il semble que ce soit celle du voyage même, et des grandes routes. Il a un sac de toile bise, passé en besace de l’épaule droite sous l’aisselle opposée. Son teint est de brique ; et son nez droit, maigre, paraît sculpté. Il a un regard calme et muet. Il sent la mer, les aventures, les soleils lointains, les péripéties monotones des chemins ; il a un air de voile, – de ces voiles tannées, rapiécées, si belles, quand la frise les tend sur le mât d’un vieux lougre. Ce pourrait être Ulysse naufragé. »
Le voici dans l’altière Brest un soir d’automne, humide et tiède : « Le soleil est descendu sur le Goulet, comme une orange de feu sur une pente de jade ; et, disparu, sa lueur sous le ciel, à l’occident, illumine les plumes des nuages : sur le large, c’est un paon décapité, la tête en bas, qui fait la roue sanglante. »
Marseille maintenant : « Marseille, incendie en plein jour, flambe au soleil. Je vais la voir brûler jusqu’à la nuit venue. Une heure encore la sépare du soleil couchant. Tantôt, j’étais au château Fallet. De là, Marseille dans un profond silence, dans un secret divin, loin de tout bruit et de tout mouvement, était une fleur d’améthyste, un lit de lavande et de lilas. On n’aurait pas conçu de voir en rêve une île plus virginale, une plus pure Bérénice dans son voile de mauve argentée, brodée de doux azur, et lançant comme un soupir ses minarets de Perse. »
Il voyage aussi à plusieurs reprises en Italie – parcourant notamment la Sicile et Venise, point de jonction entre l’Occident et l’Orient – mais aussi dans le bassin méditerranéen, particulièrement la Grèce.
Lettre à Romain Rolland du 9 juillet 1900 : « Je sens toute la nature – sa puissance et la vanité du reste. Il est inconcevable qu’on vive – que nous, du moins vivions dans les villes. Un jour dans la campagne est plus riche de faits vivants qu’une saison dans Paris. Là-bas, ils mentent tous, et tous se répètent. A la mer, sous le ciel, dans les bois, dans les champs, tout est invention originale – et rien jamais ne ment. J’aurais bien de la peine à sortir d’ici. »
A Georges Rouault, de Hyères, le 11 décembre 1913 : « La lumière me baigne. La lumière me pénètre. Je retrouve la lumière. La lumière me rend à ces grands états de l’âme, terribles peut-être, où rien, absolument rien ne compte plus à mes yeux que la beauté : alors, on rêve cruellement de se rendre libre de tout, et qui sait ? de la vie même. »
On pourra lire aussi les lettres au critique, par ailleurs conseiller culturel français au Liban et en Syrie, Gabriel Bounoure, considéré de Claudel, Jabès à Derrida comme un lecteur exceptionnel, leur correspondance – inédite – constituant une excellente introduction à l’œuvre complet de Suarès.
Si chacun admire l’autre, il n’est bientôt plus possible de distinguer le maître de son commentateur, tant tous deux pensent la poésie comme la seule véritable consolation pour les temps obscurs dont ils font l’épreuve.
Cette correspondance traverse deux guerres, Suarès étant réformé en 1914, quand le capitaine Bounoure, pourtant très tôt et profondément meurtri de la perte d’un jeune ami peintre sur le front, veut la victoire absolue contre « les Barbares ».
Suarès lui envoie ces mots le 24 juin 1919 : « Ceux de l’arrière et du plat pays ne peuvent pas savoir quelle Cassandre captive vous ramenez dans vos bagages. La terrible voyante vous suit, que vous avez conquise dans votre voyage aux tranchées de l’enfer. Ô le grave et tragique retour : même si vous êtes accueilli par l’idylle, vous ne pourrez jamais dépouiller le réel de la tragédie. »
Gabriel Bounoure écrivit dans la préface à Marelles sur le parvis (publié chez Fata Morgana en 1975 – on y trouve également un texte très éclairant sur les dernières paroles, spinoziennes/pascaliennes, de Suarès, mort en 1948), texte considéré par Philippe Jaccottet, rappelle Edouard Chalamet-Denis, comme l’un des plus beaux essais consacrés au mystérieux pouvoir de la poésie : « Le temps de la nécessité et du destin ramenait le temps des incantations et c’est là, sans doute, l’expérience centrale de notre vie. La guerre avait creusé le temps et l’espace, créé d’immenses étendues pleines de décombres. N’était-ce pas ces espaces vides dont la magie a besoin pour que la fascination se produise ? Cette distance au bout de laquelle l’œuvre apparaît douée d’une présence chargée de signes, cette distance comprenons qu’elle est nécessaire pour que l’œuvre nous soit révélation au centre d’un lieu vacant. Eh bien, c’est la guerre, ce sont les guerres qui donnèrent aux poèmes de nos choix cet isolement qui fit leur proximité à notre âme. »
Et dans une lettre à Suarès datée du 31 décembre 1917 : « Rien ne nous intéresse plus, hormis les poèmes, c’est-à-dire de l’amour qui chante. Si l’on ne veut pas que, dans cette guerre, le nihilisme soit vainqueur, il faut que ce soit la poésie. Et pour nous, les combattants, puisqu’il nous faut vivre dans une action haïssable, nous voulons faire notre salut dans le royaume des poëmes. »

André Suarès, Vues sur Baudelaire, préface de Stéphane Barsacq, Editions des instants, 2021
https://editionsdesinstants.fr/
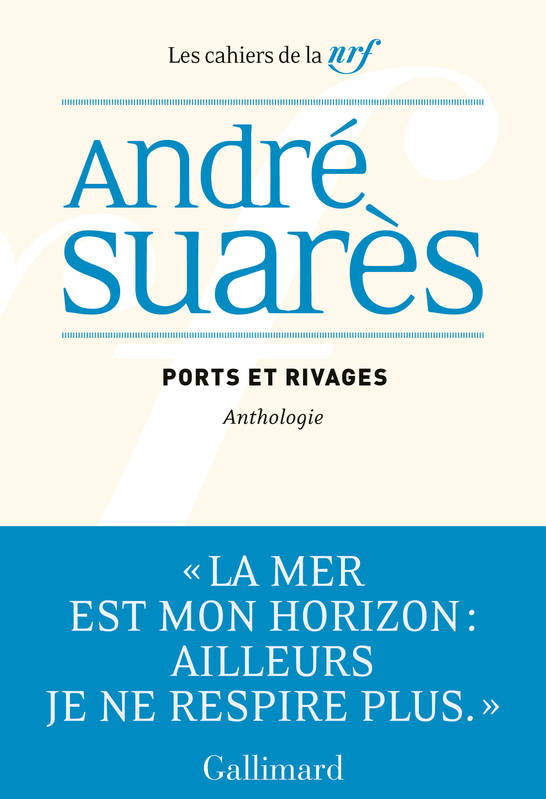
André Suarès, Ports et rivages, Anthologie, édition établie, présentée et annotée par Antoine de Rosny, Gallimard, 2021, 380 pages

André Suarès – Gabriel Bounoure, Correspondance 1913 -1948, édition établie et présentée par Edouard Chalamet-Denis, Gallimard, 2023, 360 pages
