
Autoportrait (près du Golgotha), 1896, Paul Gauguin, huile sur toile, Museu de Arte de Sao Paulo Assis Chateaubriand
« Un crabe qui tient un papillon en l’air au-dessus de lui entre ses pinces. »
Autoportrait dans l’atelier est l’un des plus beaux livres du philosophe Giorgio Agamben, peut-être son plus beau.
Il s’agit d’un autoportrait intellectuel, bâti au prisme des différents bureaux de l’écrivain, et de ses amitiés majeures.
« C’est le moment où il nous semble ne plus pouvoir ni vouloir rien avoir. Où il nous semble seulement vouloir débarrasser, faire de l’espace – mais même pour cela, il est tard désormais. »
Pas de maître revendiqué – lire cependant la fin de cet article -, mais un compagnonnage profond avec des œuvres et des amis avec qui penser.
« Je pense que l’on ne peut pas prendre entre ses mains un livre que l’on aime sans éprouver un battement de cœur, ni véritablement connaître une créature ou une chose sans renaître en elle ou avec elle. »
Publié chez L’Arachnéen, cet ouvrage à l’iconographie passionnante mêle l’archive personnelle de l’auteur (des photographies, des notes, des couvertures de livres) et des peintures ou œuvres graphiques ayant compté pour lui (Titien, Gauguin, Bonnard, Giovanni Serodine).
On y voit quelques pans de ses bibliothèques, et les objets d’une vie (un Polichinelle, une photo de Robert Walser, le portrait de Heidegger).
« Je suis un épigone au sens littéral du terme, un être qui ne se génère qu’à partir des autres et ne renie jamais cette dépendance, qui vit dans une épigenèse continuelle, heureuse. »
Ayant essentiellement travaillé à Venise et à Rome, Giorgio Agamben dévoile ici l’intimité de ses ateliers d’écriture, qui marquent des puissances (d’études, de concentration, d’idées), mais sont aussi des preuves, celles d’un penseur ayant su trouver à plusieurs reprises le lieu et la formule.

Le Supplice de Marsyas, Tiziano Vecellio – vers 1570 -1576, huile sur toile, musée archiépiscopal de Kromeriz
Autoportrait dans l’atelier est un exercice d’admiration, pour le peintre franco-israélien Avigdor Arikha, pour l’intellectuel espagnol José Bergamin, pour la romancière italienne Elsa Morante, pour le poète Giorgio Caproni, pour Herman Melville, pour Guy Debord, pour Simone Weil (à qui Agamben a dédié sa thèse de doctorat en philosophie du droit), pour Pierre Klossowski, pour Jean-Luc Nancy, pour Martin Heidegger : « Qu’est-ce qu’a été pour moi la rencontre avec Heidegger en Provence ? Je ne parviens sans doute pas à la séparer de l’endroit où elle s’est déroulée – son visage à la fois doux et sévère, ces yeux si vifs et intransigeants, je ne les ai vus nulle part ailleurs sinon en rêve. Il y a dans la vie des événements et des rencontres à tel point décisifs qu’ils ne peuvent entrer complètement dans la réalité. »
En 1966, c’était le premier séminaire de Thor, animé par le génial philosophe allemand invité par René Char, et le souvenir de la présence de Jean Beaufret, de François Fédier, de Dominique Fourcade.
« L’union du cœur et de l’esprit s’est accomplie brusquement – je m’en souviens avec clarté – en mai 1976, au moment précis où me parvint la nouvelle de la mort de Heidegger. J’ai senti que je laissais définitivement derrière moi les doutes et les indécisions, et ma certitude nouvelle s’exprima dans deux gestes : la dédicace « A Martin Heidegger in memoriam » du livre que je venais d’achever (Stanze) et le tirage à cinquante exemplaires, pour les amis, de Prose – une sorte d’adieu à la poésie au nom d’une pratique poétique que je n’abandonnerais plus : la philosophie, la « musique suprême ». »
Car la philosophie pour Agamben, comme pour Wittgenstein, repose sur un principe essentiellement poétique : l’écoute fine de la parole en tant que parole, et la conscience du lien entre les vivants et les morts, les phrases et les silences.
« L’être-au-monde et l’ouvert de Heidegger doivent être complétées avec ce sens plus antique et oublié du terme « monde » : l’homme n’habite pas seulement dans l’ouvert de l’être, mais aussi et avant tout dans le passage entre passé et présent, entre les vivants et les morts, et c’est grâce à cette demeure souterraine qu’il peut ne pas oublier l’ouvert. »
Venise : « J’ai appris à devenir intime avec Venise, à découvrir qu’une ville morte peut être, comme un spectre, secrètement plus vivante non seulement que ses habitants, mais aussi que presque toutes les villes que j’ai connues. »
Il y a l’ouvert, les villes capitales, et la violence brute.
Souvenir de la scène cardinale de la première injustice d’un homme violenté dans la rue, sorte de Bartleby ou de personnage kafkaïen criant en sanglotant : « Je suis le comptable Ghislanzoni, je suis la comptable Ghislanzoni… »
Le philosophe trouvera dans les Ecrits de Londres de Simone Weil (publiés par Albert Camus) une juste formulation de ce qu’il développera par la suite comme une critique du droit (les volumes Homo sacer), conscient avec l’auteure de La pesanteur et la grâce que « seuls des êtres humains tombés dans l’état extrême de la dégradation sociale peuvent dire la vérité » : « Ce qui est sacré, bien loin que ce que soit la personne, c’est ce qui, dans un être humain, est impersonnel. » / « La joie est un besoin essentiel de l’âme. Le manque de joie, qu’il s’agisse de malheur ou simplement d’ennui, est un état de maladie où l’intelligence, le courage et la générosité s’éteignent. C’est une asphyxie. La pensée humaine se nourrit de joie. »
Le portrait de José Bergamin, dit Pepe, est superbe, faisant songer à un Pasolini andalou : « Je me souviens qu’un jour, il me dit s’être rendu compte que le peuple espagnol était mort avant lui et que c’était le moment le plus tragique de toute sa vie. Survivre à son propre peuple, c’est notre condition, mais c’est, peut-être, aussi l’extrême condition poétique. »
Cet aveu est aussi très beau, qui est très vrai : « Quand on en vient à entrer dans une intimité matérielle – c’est-à-dire philologique – avec l’œuvre d’un auteur, quand, à la lecture de ses livres, le pouls s’accélère, se produisent alors des phénomènes qui semblent magiques, mais qui ne sont en fait que le fruit de cette intimité. Il arrive ainsi que, en ouvrant un livre au hasard, on trouve le passage qu’on y cherchait, qu’une question obsédante trouve subitement sa réponse ou sa juste formulation – ou encore, comme cela m’est arrivé avec Benjamin, que l’on finisse par tomber physiquement sur des choses et des personnes qu’il a vues et touchées. »

Allégorie de la science, vers 1625, Giovanni Serodine, huile sur toile, Pinacothèque ambrosienne, Milan
Dans ses laboratoires de recherche, Giorgio Agamben médite sur les règles monastiques, la peinture comme parole fondamentale, l’œuvre de Walter Benjamin : « Pendant les dernières années à Paris, Benjamin vivait dans une telle misère qu’il ne pouvait se permettre d’acheter du papier. » / « Qu’est-ce que je dois à Benjamin ? La dette est si incalculable que je ne saurais même ébaucher une réponse. Mais sûrement une chose : la capacité d’extraire et d’arracher de force de son contexte historique ce qui m’intéresse pour lui redonner vie et le faire agir dans le présent. L’opération doit être exécutée avec toutes les précautions philologiques, mais jusqu’au bout et avec détermination. Sans cela, mes incursions dans la théologie, le droit, la politique, la littérature, n’auraient pas été possibles. »
Plus loin : « Son érudition est si profonde qu’elle retrouve toujours la fraîcheur de la barbarie. »
Plus loin encore, cette pensée de fond définissant une ligne morale essentielle dans les désastres du temps : « Comme lui, nous aussi, nous écrivons pour une humanité qui ne s’attend plus à rien et de laquelle nous n’attendons rien – c’est pourquoi nous ne pourrons en aucun cas manquer notre rendez-vous avec elle. »
Entre l’hymne (célébration du nom) et l’élégie (célébration de la phrase dans la conscience de la caducité du nom), la vérité réside peut-être en Polichinelle, dont le philosophe est un ami : « La voix – le geste – de Polichinelle montre qu’il y a encore quelque chose à dire quand il n’est plus possible de parler, comme ses lazzis montrent qu’il y a encore quelque chose à faire quand toute action est devenue impossible. »
Dans l’invivable, écrire et penser l’impossible, comme des cantaores saisis par le duende, soulevant leur public, et abolissant dans une nuit d’inouï le poids des nécessités historiques.
N’aller nulle part, ne se soutenir d’aucune autorité ou prestige, être comme l’ami Claudio Rugafiori, – élève spirituel de l’écrivain triestin Roberto Balzen -, « peut-être la seule personne qui ait exercé pour moi la fonction d’un maître », celui qui efface tout lieu possible, tout académisme, toute prétention surplombante.
Etre un maître ignorant.
Etre l’ignorance savante.
Etre avec chacun la fragilité, le tremblement de la voix, le désir encore palpable de l’agonisant tombant devant le bison de Lascaux.
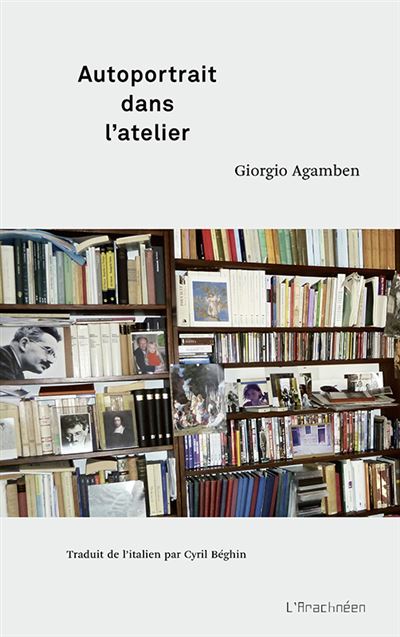
Giorgio Agamben, Autoportrait dans l’atelier, traduit de l’italien par Cyril Béghin, conception graphique David Poullard et Anaïs Masson, L’Arachnéen, 136 pages
